| | | L'âge de la terre |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
OlivierV
Moderateur

 |  Sujet: L'âge de la terre Sujet: L'âge de la terre  Dim 21 Jan 2018, 10:08 Dim 21 Jan 2018, 10:08 | |
| Pascal RICHET, « TERRE ÂGE DE LA », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 17 janvier 2018. URL : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
|   | | OlivierV
Moderateur

 |  Sujet: Re: L'âge de la terre Sujet: Re: L'âge de la terre  Dim 21 Jan 2018, 10:11 Dim 21 Jan 2018, 10:11 | |
| Que la Terre et même l’Univers aient un âge est de nos jours une évidence. Le fait que ces âges se comptent par milliards d’années est lui-même couramment connu : 4,55 pour la Terre et sans doute environ trois fois plus pour l’Univers, comme l’ont respectivement établi les géochimistes au milieu du xxe siècle et les cosmologistes dans les décennies suivantes. Or ces résultats furent l’aboutissement d’une très longue quête qui débuta dès l’Antiquité gréco-romaine et peut être découpée en quatre grandes périodes se recoupant partiellement. La première débuta vers le ve siècle avant notre ère avec les premiers philosophes grecs ; elle fut philosophique, en ayant eu pour trait saillant que, malgré leurs présupposés divergents, toutes les écoles antiques s’accordèrent sur l’idée que le monde – Terre incluse – n’avait pas été créé ex nihilo. Du début de notre ère jusqu’au xviiie siècle, la deuxième période fut théologique ; elle s’inscrivit en effet dans le cadre d’une création temporelle du monde telle qu’elle avait été révélée par le récit biblique de la Genèse, à partir duquel des âges de la Terre et du monde de quelques milliers d’années seulement furent déduits. Du début du xviiie siècle à la fin du xixe, la troisième période fut naturaliste ; elle se trouva marquée par de nouvelles manières d’observer la nature qui mirent peu à peu en cause ces très courtes échelles de temps, en n’ayant toutefois pu établir de chronologies que relatives. De véritables datations durent donc attendre le début de la dernière période, physique, pour voir le jour à la fin du xviiie siècle ; l’âge de la Terre passa alors de dizaines de milliers à des centaines de millions d’années avec la physique classique, et enfin à des milliards d’années au début du xxe siècle, quand la physique nucléaire vit le jour. En toile de fond de l’histoire de l’âge de la Terre se trouve ainsi une histoire générale des sciences, elle-même mâtinée de considérations philosophiques et théologiques puisque la question était bien sûr intimement liée au problème clé qui s’est toujours posé à l’homme, celui de l’origine du monde.
La force du raisonnement philosophique
Tout comme le jour et la nuit, les saisons, les années et les générations semblent se répéter inlassablement. D'un bout à l'autre de la Terre, il en résulta une conception du temps qu’on a qualifié de cyclique. Comme l’a résumé Mircea Eliade dans son classique Mythe de l’éternel retour, « tout recommence à son début à chaque instant. Le passé n’est que la préfiguration du futur. Aucun événement n’est irréversible et aucune transformation n’est définitive. Dans un certain sens, on peut même dire qu’il ne se produit rien de neuf dans le monde, car tout n’est que la répétition des mêmes archétypes primordiaux ».
Un tel cadre se trouva conservé quand les grandes écoles philosophiques grecques furent fondées en un siècle et demi seulement par Démocrite (~460-~370), Platon (~428-347), Aristote (~385-~322), Épicure (~341-~270) ou Zénon de Cittium (~335-~264), le premier stoïcien. La question la plus importante, celle de l’origine du monde, ne fut bien sûr pas laissée de côté. Dans la grandiose cosmologie de son dialogue le Timée, Platon affirma que le monde avait connu un début : il lui attribua comme auteur un démiurge ayant ordonné la khôra, un « réceptacle » qui fut peu après considéré comme une matière informe. En dépit de leurs désaccords fondamentaux, les atomistes et les stoïciens partagèrent l’idée que le monde passait continuellement par des cycles de formation et de destruction, ces destructions résultant respectivement du hasard des collisions atomiques et de conflagrations générales d’origine divine.
Sur le long terme, les idées qui exercèrent l’influence la plus longue et la plus forte furent cependant celles d’Aristote. En décrivant un petit univers centré sur la Terre et borné par la sphère des étoiles fixes, ce dernier s’attacha à démontrer aussi bien philosophiquement que physiquement pourquoi le monde était nécessairement éternel. Si on supposait par exemple que le temps avait connu un début, on devait alors admettre une absence de temps auparavant, ce qui était absurde puisque la notion d’« auparavant » présupposait l’existence du temps. De même, un mouvement ne pouvait pas se produire spontanément : soit il existait de toute éternité, soit il résultait de l’action d’un autre mouvement qui était lui-même soit éternel, soit le produit d’encore un autre mouvement, et ainsi de suite. Quant à l’existence d’un monde céleste de toute évidence immuable, elle témoignait aussi de l’éternité du temps puisque l’incorruptibilité était par définition absolue. Dans son traité Du Ciel, Aristote conclut ainsi que « le ciel tout entier n’a pas été engendré et ne peut donc plus périr, comme certains le disent de lui, mais qu’il est un et éternel, n’ayant ni commencement ni fin à sa durée tout entière, et qu’il tient et contient en lui-même le temps infini, voilà ce dont on peut être convaincu ».
Tout comme le monde, le temps était incréé en se trouvant indissolublement lié au mouvement des astres. Dans un monde éternel, la Terre n’était pas pour autant localement immuable. Elle restait simplement soumise aux mêmes types de transformation qui pouvaient l’affecter. « Puisque le temps ne s’épuise pas et que l’Univers est éternel », Aristote affirma dans les Météorologiques que « les fleuves naissent et meurent et que ce ne sont pas toujours les mêmes lieux de la Terre qui sont immergés ». L’important était cependant que, « sur toute la Terre ce ne sont pas toujours les mêmes régions qui sont les unes une mer, les autres un continent, mais que toutes changent avec le temps ». Certes, tout changeait avec le temps, mais la Terre restait globalement inchangée de sorte qu’il n’était le siège d’aucune irréversibilité et qu’aucune évolution ne s’y produisait jamais. Une nature où tout était gouverné par les cycles éternels d’astres eux-mêmes immuables ignorait par définition toute histoire. L’idée de reconstituer son passé était proprement inimaginable.
Indépendamment du fait qu’elles divergeaient sur l’éternité du monde, sa création temporelle, ses formations et destructions périodiques, toutes les écoles grecques postulaient que la matière était éternelle. Très précocement, Parménide d’Élée (~vie-ve s. av. J.-C.) avait ainsi affirmé que « l’être est en effet, mais le néant n’est pas », en accord avec Démocrite selon qui « rien ne saurait être engendré à partir du non-être et rien ne saurait, en se corrompant, retourner au non-être ». La matière constituait donc elle-même un principe fondamental. Étant par définition immatériel, le dieu des chrétiens avait-il alors créé le monde à la façon du démiurge platonicien en ordonnant un chaos préexistant ? Après quelques hésitations dues à l’ambiguïté de la toute première phrase de la Genèse, le premier livre du Pentateuque, « Au commencement Dieu fit la Terre et le Ciel », une réponse négative allait être apportée par le dogme de la Création ex nihilo. Mais celui-ci représenterait une absurdité totale à l’aune de la philosophie grecque parce que l’idée selon laquelle « rien ne naît de rien » était pour les Anciens le fondement de toute philosophie de la nature. |
|   | | OlivierV
Moderateur

 |  Sujet: Re: L'âge de la terre Sujet: Re: L'âge de la terre  Dim 21 Jan 2018, 10:12 Dim 21 Jan 2018, 10:12 | |
| La chronologie : une préoccupation chrétienne
Accepté au Moyen Âge aussi bien à Byzance que dans le monde musulman et en Occident, le petit univers d’Aristote centré sur la Terre ne fut pas remis en cause pendant près de deux millénaires. L’éternité du monde fut en revanche vite contestée par les chrétiens parce qu’elle contredisait clairement le tableau biblique de la Création minutieusement brossé par la Genèse. Pour les tout premiers chrétiens, la création du monde n’était cependant encore ni une affaire de dogme ni un problème cosmologique. En tant qu’épisode d’une histoire centrée sur l'Homme, elle était un acte divin dont la réalité ne faisait l’objet d’aucun doute et n’appelait d’ailleurs aucune explication philosophique en étant reléguée à l’arrière-plan par l’Incarnation et la Passion du Christ.
Ce fut au milieu du iie siècle que la question du type de création prit une grande importance dans le cadre de polémiques avec les sectes gnostiques. Celles-ci avaient en effet soulevé un sérieux problème théologique : si toute chose avait une origine divine, comment le Dieu bon des Écritures aurait-il pu être à la source du mal ? Et comme Dieu n’avait pu créer le monde à partir de lui-même, en raison de son indivisibilité et de son immuabilité, la seule façon d’expliquer l’existence du mal était de supposer une création de type platonicien, faite à partir de matière préexistante. Selon différents schémas, il devenait alors possible d’imaginer comment un cosmos manifestement imparfait avait été créé non par Dieu, mais par des êtres célestes de moindre rang qui l’avaient ignoré ou s’étaient rebellés contre lui après que les Cieux eurent été créés.
Pour les chrétiens, ces explications posaient en retour une difficulté considérable puisque la liberté divine n’aurait pas été absolue, mais contrainte par la nature de cette matière informe par rapport à laquelle Dieu n’aurait joui d’aucune prééminence ontologique. Dans son Contre Hermogène, l’apologiste Tertullien (~155-~225) résuma l’ampleur du problème en imaginant une matière éternelle se comparer à Dieu :
« Moi aussi je suis la première, moi aussi je précède toutes les choses, moi aussi je suis la source de toutes les choses ; nous étions égaux, nous existions ensemble, tous les deux, sans début ni fin, tous les deux sans auteur ni dieu. Qui peut me soumettre à un Dieu contemporain et coexistant ? Si c’est parce qu’il s’appelle Dieu, moi aussi j’ai mon propre nom. À moins que je ne sois Dieu et lui la matière, puisque nous sommes tous les deux ce qu’est l’un d’entre nous ? »
La préexistence d’un chaos platonicien devait donc être fermement rejetée comme le justifièrent Tertullien et Tatien l’Assyrien (~120-apr. 173) à Rome ou les évêques Théophile (mort apr. 180) à Antioche et saint Irénée (~130-~208) à Lyon. Indépendamment les uns des autres, ces auteurs transformèrent de la sorte la question cosmologique de la formation du monde soulevée par les gnostiques en un problème théologique : en dépit de leurs arrière-plans différents, leur affirmation commune d’une Création ex nihilo souligna l’unité, la puissance absolue et la liberté absolue de Dieu en évoquant le mystère insondable d’une œuvre dont seule l’origine divine ne faisait aucun doute.
Rapidement, cette thèse d’une Création ex nihilo se diffusa chez les chrétiens en devenant même un de leurs principaux articles de foi. Pour l’étude de la nature, une de ses conséquences les plus notables fut de bouleverser la notion du temps défendue par les écoles grecques. Alors que la Création marquait évidemment son début, le temps acquérait une direction irréversible puisqu’il était impensable de supposer que la Passion du Christ et le Jugement dernier se répéteraient. Ce fut donc ce passage d’un temps de nature cyclique à un temps linéaire qui rendit possible l’idée que le monde avait un âge. Or le fait que cet âge pouvait être déterminé fut lui aussi le fruit des controverses religieuses de l’époque, car l’ancienneté d’un culte était considérée comme un gage de son authenticité. À la suite de l’historien juif Flavius Josèphe (37-~100), les chrétiens revendiquèrent donc leur filiation juive pour démontrer par une exégèse minutieuse des Écritures que Moïse était bien plus ancien que tous les sages grecs. Mais ils purent aller beaucoup plus loin dans cette voie en raison du fait qu’une chronologie pouvait désormais être absolue, et non plus seulement relative, puisque la création du monde était son évident point de départ.
L’idée se fit donc jour que l’histoire humaine se confondait avec celle du monde depuis le tout premier moment de la Création. Or cet instant pouvait être daté précisément. Théophile l’illustra quand il affirma que 5 695 ans s’étaient déjà écoulés à la mort de l’empereur Aurelius Verus (en l’an 169). La méthode consistait en un décompte minutieux des années quand on suivait, génération après génération, la descendance d’Adam et Ève que décrivait le Pentateuque et les événements historiques rapportés par l’Ancien Testament. Telle qu’elle fut aussi mise en œuvre par de nombreux autres apologistes, la méthode fournit initialement des âges de 5 000 à 6 000 ans. Indépendamment de toute considération de philosophie naturelle, les courtes échelles de temps de ces chronologies mosaïques (car tirées du Pentateuque, qu’on pensait avoir été écrit par Moïse) s’enracinèrent profondément chez les chrétiens en raison de l’autorité incontestée des Écritures.
Accompagnant le nouveau sens de l’histoire qui émergeait, une obsession inédite pour la chronologie apparut alors. Qu’aurait en effet été une histoire dépourvue de dates précises, et donc de fermes points de repère ? Mais l’histoire n’était plus celle du seul peuple juif. Elle était devenue universelle. Par définition, l’annus mundi, l’année de la Création, était le point de départ de l’« ère mondiale ». Pour résoudre les incertitudes qui entachaient sa détermination, il apparut qu’une meilleure précision pouvait être obtenue sur la base de considérations astronomiques. On savait que la Passion du Christ avait eu lieu le 14 nissan à la pleine lune. Il était en outre raisonnable de penser que le monde avait été créé à un moment noble des révolutions célestes. De ce point de vue, l’équinoxe de printemps fut privilégié parce qu’il était traditionnellement retenu comme longitude de référence en astronomie. En partant de la date de la Passion, le problème consistait à déterminer en combien d’années on remontait à cet équinoxe par des cycles luni-solaires appropriés. Une des solutions obtenues à Byzance s’imposa pour fixer la Création le 23 mars, 15 jours avant la première apparition de la lune et 5 509 ans avant la Passion. Ainsi définie, l’« ère mondiale » resta la référence calendaire officielle à Byzance jusqu’à la fin de l’Empire et même encore ensuite en Russie. |
|   | | OlivierV
Moderateur

 |  Sujet: Re: L'âge de la terre Sujet: Re: L'âge de la terre  Dim 21 Jan 2018, 10:13 Dim 21 Jan 2018, 10:13 | |
| Les fossiles, marqueurs du temps
Pour les chrétiens, l’histoire prenait un nouveau sens de suite ordonnée, et non plus de séquence quasiment aléatoire d’événements. Le changement fut particulièrement bien illustré par la première chronologie « universelle » que l’évêque Eusèbe de Césarée (~265-av. 341) établit par le biais d’habiles rapprochements effectués entre systèmes chronologiques différents : ceux des Romains et des Grecs furent par exemple mutuellement calés par le fait que Rome avait été fondée la première année de la septième olympiade. Que l’histoire de la Terre devait s’inscrire dans ce même cadre chronologique fut illustré par Eusèbe quand ce dernier attribua au Déluge la présence des diverses sortes de poissons trouvés au sommet du mont Liban. En reliant un vestige de l’histoire de la Terre à un épisode bien défini de l’histoire humaine, et donc en même temps du monde, Eusèbe fut ainsi l’auteur de la toute première datation géologique « absolue ».
Mais un problème épineux apparut quand, comme le fit saint Augustin (354-430), on constata que des âges systématiquement moins élevés étaient tirés de la Vulgate, la traduction latine de la Bible, que des Septante, la version grecque produite à Alexandrie au iiie siècle avant notre ère à l’intention de la diaspora juive hellénisée. Pendant près de quinze siècles, des trésors d’érudition furent déployés par d’éminents esprits pour tenter de résoudre ces désaccords. Le grand Isaac Newton (1642-1727) fut un des derniers à participer au débat par une savante Chronologie des anciens royaumes, publiée à titre posthume, où il concluait que le monde n’avait que 4 000 ans. Mais la lassitude avait fini par gagner les esprits devant l’inanité des efforts déployés pour établir un âge indiscutable. Dans sa Chronologie de l’histoire sainte, Alphonse des Vignoles (1649-1744), un des premiers directeurs de l’Académie des sciences de Berlin, déplora ainsi en 1738 avoir lui-même recueilli « plus de deux cents calculs différents, dont le plus court ne compte que 3 483 ans depuis la Création du Monde jusqu’à Jésus-Christ : et le plus long en compte 6 984. C’est une différence de 35 siècles. »
En parallèle, les fossiles étaient peu à peu revenus sur le devant de la scène, car leur ubiquité jusqu’aux sommets des hautes montagnes rendait difficile d’attribuer leur dépôt au seul épisode du Déluge. On put douter de leur origine organique en imaginant qu’ils étaient des « jeux de la nature », des contrefaçons minérales croissant lentement dans les profondeurs de la Terre, tout comme on voyait croître les concrétions dans les galeries de mines ; on imagina même qu’ils pouvaient se reproduire dans les profondeurs de la Terre. Cependant, de solides arguments en faveur d’une origine organique ne manquaient pas, comme l’avaient déjà avancé Bernard Palissy (~1510-1590) et d’autres observateurs avisés. Anatomiste danois au service du duc de Toscane, Nicolas Sténon (1638-1686) le démontra rigoureusement après qu’on lui eût demandé un jour d’examiner la tête d’un grand requin. La similitude des dents de l’animal avec les glossopètres, de petites pierres auxquelles étaient prêtées diverses vertus, le conduisit alors à vouloir élucider leur mode de formation. C’est ainsi qu’il fut conduit à décrire de manière plus générale comment coquillages ou poissons se pétrifiaient et d’énoncer qu’ils le faisaient au sein de sédiments déposés horizontalement au fond des lacs et des mers. Et l’empilement de leurs strates révélait l’ordre de leur dépôt, reconnut Sténon en marquant véritablement la naissance de la géologie : reconstituer le passé de la Terre, plissements et autres accidents tectoniques inclus, était en effet devenu possible.
La découverte d’innombrables volcans éteints dans la deuxième moitié du xviiie siècle, puis ensuite celle d’anciennes glaciations, illustrèrent également que la surface de la Terre avait grandement varié au cours des siècles. Or de tels changements étaient imperceptibles à l’échelle des civilisations humaines. On dut peu à peu en conclure que les échelles de temps mosaïques étaient bien trop courtes. D’intérêt particulier fut alors une autre découverte, celle que certains fossiles appartenaient à des espèces dont aucun individu vivant n’avait jamais été vu ; c’était en particulier le cas de grands mammifères qui, tel le mastodonte, n’auraient certainement pas échappé à l’observation. Ces espèces étaient donc éteintes, en ayant vécu à des périodes bien définies de l’histoire de la Terre. En retour, il devint possible d’employer celles de ces espèces qui avaient connu de vastes distributions géographiques pour établir une chronologie relative : d’un bout à l’autre de la Terre, des corrélations furent dans ce but effectuées entre strates au sein desquelles se trouvaient les mêmes fossiles caractéristiques. Sans s’en rendre compte, les géologues qui s’attachèrent à cet exercice empruntèrent en tout point la démarche suivie par Eusèbe quinze siècles plus tôt pour son histoire universelle.
Si les ères géologiques et leurs diverses subdivisions purent ainsi être définies à partir du début du xixe siècle, rien ne pouvait cependant être dit sur leurs durées respectives. La question devint spécialement épineuse quand la théorie de l’évolution fut simultanément présentée à Londres par Charles Darwin (1809-1882) et Alfred Russell Wallace (1823-1913). Tandis que le second assurait que quelques dizaines de millions d’années avaient suffi pour produire les formes de vie les plus évoluées, le premier postulait des durées considérablement plus longues. Les deux naturalistes avaient de fait pris des partis divergents dans un grand débat qu’avait lancé le physicien William Thomson (1824-1907), plus connu sous le nom de Lord Kelvin. |
|   | | OlivierV
Moderateur

 |  Sujet: Re: L'âge de la terre Sujet: Re: L'âge de la terre  Dim 21 Jan 2018, 10:15 Dim 21 Jan 2018, 10:15 | |
| La rigueur de la physique
La lointaine origine de ce débat remontait à des réflexions de Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), qui s’était lui-même inspiré de René Descartes (1596-1650) et de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) pour postuler que la Terre avait initialement été une masse en fusion arrachée du Soleil lors de l’impact d’une comète. L’idée de Buffon fut alors de mesurer les vitesses de refroidissement de boulets de différentes matières chauffées à blanc, qu’il extrapola audacieusement à des objets de la taille des planètes. Pour la Terre, il détermina de la sorte que 75 000 ans s’étaient écoulés avant qu’elle ne devienne habitable et qu’elle le resterait ensuite 80 000 ans. En ayant par ailleurs observé les vitesses très faibles auxquelles des sédiments se déposaient dans la mer, Buffon consigna en vérité dans ses carnets un âge de dix millions d’années. S’il préféra ne pas le publier, ce ne fut pas en raison de la censure ecclésiastique, mais parce qu’il jugea que l’immensité d’une telle durée ne pourrait pas être appréhendée par ses contemporains.
Un des effets les plus notables du problème cosmologique soulevé par Buffon fut d’inciter Joseph Fourier (1768-1830) à élaborer sa célèbre théorie de la propagation de la chaleur, dans laquelle il introduisit une distinction fondamentale entre les capacités qu’avait une substance de conduire et d’accumuler cette chaleur. Jugeant que ces deux variables n’étaient pas connues, Fourier s’abstint toutefois finalement de toute application au refroidissement de la Terre. Grand admirateur de Fourier, Kelvin fut plus audacieux en s’appuyant également sur les deux principes de la thermodynamique entre-temps énoncés (conservation de l’énergie et augmentation d’entropie d’un système isolé). En supposant assez arbitrairement que la température initiale de la Terre avait été de 3 870 0C, il calcula avec les paramètres thermiques jugés appropriés qu’il avait fallu de 20 à 400 millions d’années pour que le profil de température observé à la surface de la Terre (le gradient géothermique) atteigne sa valeur mesurée d’environ 30 0C par kilomètre. Le résultat était spécialement probant, car il s’accordait à l’âge déterminé pour le Soleil par une tout autre méthode : si l’énergie fournie par un combustible comme le charbon ou par la chute de comètes sur le Soleil était très insuffisante pour assurer le flux connu de chaleur solaire, celle que libérait une contraction gravitationnelle du Soleil sur lui-même autorisait en revanche des durées de 40 à 100 millions d’années.
Pour leur part, les géologues avaient eu tendance à évoquer des temps beaucoup plus longs. Le débat ainsi lancé fut d’autant plus vif que Kelvin ne cessa de reprendre ses calculs pour annoncer des durées de plus en plus courtes, qu’il limita à 24 millions seulement en 1893 à partir de paramètres thermiques qu’il pensait plus précis. Sa position fut cependant vite rendue intenable à la suite de la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel (1852-1908), puis des travaux de Pierre (1859-1906) et Marie Curie (1867-1934) sur l’uranium, le thorium et le radium, le premier nouvel élément chimique qu’ils découvrirent. Les calculs de Kelvin présupposaient l’absence de sources de chaleur interne à la Terre. Or Pierre Curie observa en 1903 avec son collaborateur Albert Laborde que les effets thermiques de la radioactivité étaient énormes et il démontra en outre que l’intensité des rayonnements émis décroissait avec le temps d’une manière rigoureusement exponentielle. Comme il le souligna, le temps pouvait désormais être mesuré de manière absolue, indépendamment du mouvement des astres.
La première datation géologique suivit rapidement. En 1905, elle fut l’œuvre du physicien anglais Ernest Rutherford (1871-1937) qui tira profit du fait que la désintégration de l’uranium et du thorium produisait une quantité d’hélium qui représente aussi une mesure du temps. Avec son estimation du taux de production d’hélium par l’uranium, Rutherford put déterminer l’âge d’un minéral uranifère d’après les teneurs mesurées pour ces deux éléments : accusant 140 millions d’années, ce simple minéral se révélait bien plus ancien que la Terre entière selon l’âge attribué par Kelvin ! On comprit ensuite que l’uranium et le thorium étaient les points de départ de longues chaînes de désintégration dont le terme commun était le plomb. La teneur en plomb accumulé dans un minéral uranifère constituait donc aussi un chronomètre. À Londres, Arthur Holmes (1890-1965) mit en œuvre la méthode pour dater des roches du Carbonifère, du Dévonien et du Silurien ; les âges respectifs de 340, 370 et 430 millions d’années qu’il détermina en 1911 pour ces trois périodes à partir des faibles quantités de plomb analysées furent donc les premiers jalons fermes placés sur l’échelle des temps géologiques (qui ne diffèrent que de 15, 38 et 5 millions d’années des valeurs aujourd’hui acceptées). Mais il restait bien sûr à dater la Terre elle-même. Ce qui permit de le faire fut la découverte des isotopes, de mêmes éléments chimiques ne différant que par des masses atomiques légèrement différentes. Il apparut qu’il existe deux isotopes radioactifs d’uranium, de masses 235 et 238, dont les chaînes radioactives se terminent respectivement par des plombs de masses 207 et 206. Avec leurs demi-vies de 0,71 et 4,56 milliards d’années, réalisa-t-on dans les années 1920, ces isotopes constituent deux chronomètres différents d’un même phénomène. Pour des minéraux ou des roches non altérées et de même âge, mais de teneur en uranium différente, on démontra en outre à partir des lois de la radioactivité que les compositions isotopiques du plomb suivent une loi très simple : les rapports 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb, où le plomb 204 est un isotope non radiogénique, doivent en effet définir une droite dont la pente croît avec l’âge géologique.
Pour pouvoir appliquer la méthode, une vingtaine d’années de progrès analytiques et instrumentaux furent cependant nécessaires. Il était en effet impossible de mesurer précisément des abondances isotopiques par des analyses chimiques. Ce fut le spectromètre de masse qui permit de le faire en séparant les isotopes comme un prisme décompose la lumière. Descendant des tubes cathodiques avec lesquels les rayons X, puis l’électron avaient été observés, cet instrument avait permis de découvrir les isotopes d’innombrables éléments en déviant différemment leurs ions dans le vide par des champs magnétiques et électriques. Faire de ce spectromètre un instrument de mesure précis nécessita cependant de longs travaux dans un contexte, celui de la Seconde Guerre mondiale, qui fit de l’uranium un enjeu hautement stratégique. En parallèle, il fallut mesurer avec la précision appropriée les très longues demi-vies des deux isotopes radioactifs tandis que de méthodes nouvelles de microchimie durent être mises au point pour isoler (sans les contaminer) les quantités infimes des éléments devant être analysés.
Pour déterminer l’âge de la Terre, il restait encore à résoudre une gageure, à savoir trouver des échantillons dont le plomb était représentatif de celui de la Terre entière. L’idée de l’Américain Clair Patterson (1922-1995) fut de considérer des sédiments océaniques dont le plomb constitue une moyenne de celui de vastes aires continentales. Mais comment alors définir une droite avec le seul point défini par les rapports 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb des sédiments ? À cet effet, Patterson eut l’autre idée de supposer que les météorites s’étaient formées en même temps que la Terre. Il disposa alors d’un point pour la Terre (sédiments), de deux pour des météorites de pierre (des chondrites), et de trois autres pour des météorites de fer (dont une – Canyon Diablo – était quasiment vierge d’uranium et de thorium de sorte que sa composition isotopique pouvait être considérée comme celle du plomb primordial). Patterson obtint alors une belle droite dont la pente indiqua un âge de 4,55 ± 0,07 milliards d’années. Une controverse vieille de deux mille cinq cents ans avait été close, non pas par combinaison d’outils inadéquats ou moyennes de mesures discordantes, mais par la création de méthodes complètement nouvelles : difficultés analytiques mises à part, un problème dont la complexité avait défié l’entendement des plus éminents esprits à travers les âges avait été réduit à un exercice d’algèbre pour élève de collège. |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: L'âge de la terre Sujet: Re: L'âge de la terre  | |
| |
|   | | | | L'âge de la terre |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
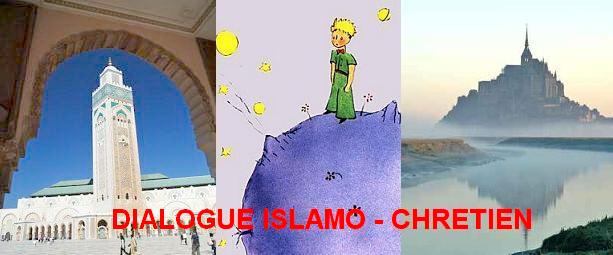




 Dim 21 Jan 2018, 10:08
Dim 21 Jan 2018, 10:08