| | | Notre rapport au hasard |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
Invité
Invité
 |  Sujet: Notre rapport au hasard Sujet: Notre rapport au hasard  Mar 11 Avr 2017, 00:42 Mar 11 Avr 2017, 00:42 | |
| 11.04.2017
Bonjour,
Je vous propose de réfléchir à notre rapport au hasard.
Je souhaite montrer que nous ne sommes pas objectifs dans notre rapport au hasard.
En effet, notre intellect nous conduit à rechercher un sens, des solutions à tout. Les faits sont pour nous des données que nous analysons pour leur chercher un sens. Il se trouve que nous sommes également dépassés par ce schéma intellectuel... car nous cherchons un sens à ce qui n'en a pas nécessairement.
|
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 11 Avr 2017, 00:43 Mar 11 Avr 2017, 00:43 | |
| Exemple:
lancons 10 fois de suite un dé.... et notons la série obtenue:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 4 4 2 3 4 1 5 6
est ce qu'une des 2 séries vous parait plus probable que l'autre?
On ne pourra s'empêcher de trouver la 1ere série bien plus improbable que la 2eme... en direct, on sera époustouflé par cette répétition... se dire qu'il n'y a pas de hasard... y chercher un sens... y voir une forme transcendance... cela crée même une certaine excitation intellectuelle tant cet atypie est peu probable!!
Pourtant, il y a strictement les mêmes chances de tomber sur la 1ere série que sur la 2eme. La 2eme série est donc tout autant atypique et peu probable. Les 2 avaient très peu de chances de se produire, mais pourtant c'est arrivé.
Mais même en le sachant, je suis sûre que vous continuez à trouver que cette série de 1 est tout de même extraordinaire..... C'est difficile de se défaire de nos schéma mentaux. |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 11 Avr 2017, 07:12 Mar 11 Avr 2017, 07:12 | |
|  excellent cette petite démonstration!!! |
|   | | rosarum

 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 11 Avr 2017, 21:42 Mar 11 Avr 2017, 21:42 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- Exemple:
lancons 10 fois de suite un dé.... et notons la série obtenue:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 4 4 2 3 4 1 5 6
est ce qu'une des 2 séries vous parait plus probable que l'autre?
On ne pourra s'empêcher de trouver la 1ere série bien plus improbable que la 2eme... en direct, on sera époustouflé par cette répétition... se dire qu'il n'y a pas de hasard... y chercher un sens... y voir une forme transcendance... cela crée même une certaine excitation intellectuelle tant cet atypie est peu probable!!
Pourtant, il y a strictement les mêmes chances de tomber sur la 1ere série que sur la 2eme. La 2eme série est donc tout autant atypique et peu probable. Les 2 avaient très peu de chances de se produire, mais pourtant c'est arrivé.
Mais même en le sachant, je suis sûre que vous continuez à trouver que cette série de 1 est tout de même extraordinaire..... C'est difficile de se défaire de nos schéma mentaux. et le même raisonnement peut il contester l'argument des croyants selon lequel la complexité de l'univers serait la preuve de l'existence de Dieu ? |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 11 Avr 2017, 22:22 Mar 11 Avr 2017, 22:22 | |
| @phoutoufoot vi ca m'amuse beaucoup aussi ce genre de bizarreries  - rosarum a écrit:
- emmanuelle78 a écrit:
- Exemple:
lancons 10 fois de suite un dé.... et notons la série obtenue:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 4 4 2 3 4 1 5 6
est ce qu'une des 2 séries vous parait plus probable que l'autre?
On ne pourra s'empêcher de trouver la 1ere série bien plus improbable que la 2eme... en direct, on sera époustouflé par cette répétition... se dire qu'il n'y a pas de hasard... y chercher un sens... y voir une forme transcendance... cela crée même une certaine excitation intellectuelle tant cet atypie est peu probable!!
Pourtant, il y a strictement les mêmes chances de tomber sur la 1ere série que sur la 2eme. La 2eme série est donc tout autant atypique et peu probable. Les 2 avaient très peu de chances de se produire, mais pourtant c'est arrivé.
Mais même en le sachant, je suis sûre que vous continuez à trouver que cette série de 1 est tout de même extraordinaire..... C'est difficile de se défaire de nos schéma mentaux.
et le même raisonnement peut il contester l'argument des croyants selon lequel la complexité de l'univers serait la preuve de l'existence de Dieu ? Nous choisissons selon des critères totalement subjectifs ce qui est extraordinaire et ce qui ne l'est pas... l'objectivité des mathématiques met le plus souvent nos jugements en défaut. (la probabilité qu'il fasse la température qu'il fait actuellement devant chez moi au millièmes près à cette heure là, ce jour là, était infiniment faible, pourtant c'est arrivé, et non on ne trouve pas ça extraordinaire. La lune est visible de très nombreuses nuits, on ne trouve jamais extraordinaire de la voir... mais si cela se produit à un moment précis il peut arriver que l'on trouve cela extraordinaire, alors que la probabilité que cela se produise est assez élevée... infiniment plus que des tas de choses qui se produisent sans cesse sans nous émouvoir.) "Il est impossible que l'improbable ne se produise jamais." Donc effectivement, l'argument de la complexité de l'univers en tant que preuve est une erreur, car une preuve c'est autre chose qu'une évaluation à la louche, de loin, surtout pour conforter une idée pré établie. Et bien entendu que la complexité de l'univers peut paraitre être un argument à défaut d'être une preuve, mais ce n'est pas un argument qui compte à mes yeux, même si je le comprends. C'est humain...... Mais c'est surtout théologiquement incorrect je pense. Car ce n'est que coller dieu, dès que cela nous parait trop compliqué, trop insensé.... c'est faire de dieu, "le dieu des lacunes", un dieu qui perd son pouvoir au fil des découvertes et des éclairages scientifiques. |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 12 Avr 2017, 01:46 Mer 12 Avr 2017, 01:46 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- @phoutoufoot vi ca m'amuse beaucoup aussi ce genre de bizarreries

- rosarum a écrit:
et le même raisonnement peut il contester l'argument des croyants selon lequel la complexité de l'univers serait la preuve de l'existence de Dieu ? Nous choisissons selon des critères totalement subjectifs ce qui est extraordinaire et ce qui ne l'est pas... l'objectivité des mathématiques met le plus souvent nos jugements en défaut.
(la probabilité qu'il fasse la température qu'il fait actuellement devant chez moi au millièmes près à cette heure là, ce jour là, était infiniment faible, pourtant c'est arrivé, et non on ne trouve pas ça extraordinaire.
La lune est visible de très nombreuses nuits, on ne trouve jamais extraordinaire de la voir... mais si cela se produit à un moment précis il peut arriver que l'on trouve cela extraordinaire, alors que la probabilité que cela se produise est assez élevée... infiniment plus que des tas de choses qui se produisent sans cesse sans nous émouvoir.)
"Il est impossible que l'improbable ne se produise jamais."
Donc effectivement, l'argument de la complexité de l'univers en tant que preuve est une erreur, car une preuve c'est autre chose qu'une évaluation à la louche, de loin, surtout pour conforter une idée pré établie.
Et bien entendu que la complexité de l'univers peut paraitre être un argument à défaut d'être une preuve, mais ce n'est pas un argument qui compte à mes yeux, même si je le comprends. C'est humain......
Mais c'est surtout théologiquement incorrect je pense.
Car ce n'est que coller dieu, dès que cela nous parait trop compliqué, trop insensé.... c'est faire de dieu, "le dieu des lacunes", un dieu qui perd son pouvoir au fil des découvertes et des éclairages scientifiques. Les jeux de hasards sont interdit dans la religion musulmane.  Si tout n'étais que hasard, ce serait le chaos. Tout ne peux s'expliquer par le fameux dieu du hasard ou des probabilités auxquels croient les athées. Et une série de numéro en lancant des dés ne prouve rien, ni sur le destin, ni sur le hasard. Mais peut être n'as tu pas ouvert ce topic par hasard, peut être étais tu destiné à l'ouvrir.  |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 12 Avr 2017, 06:42 Mer 12 Avr 2017, 06:42 | |
| - salamsam a écrit:
Si tout n'étais que hasard, ce serait le chaos. Tout ne peux s'expliquer par le fameux dieu du hasard ou des probabilités auxquels croient les athées. Et une série de numéro en lancant des dés ne prouve rien, ni sur le destin, ni sur le hasard.
Mais peut être n'as tu pas ouvert ce topic par hasard, peut être étais tu destiné à l'ouvrir.  Il n'est pas question de destin, ni d'expliquer "tout"... mais de notre manière d'appréhender le hasard. Si.... cette série de lancés de dés prouve que notre jugement est totalement à côté de la plaque quand il s'agit de hasard... Donc ta phrase "si tout n'était que hasard, ce serait le chaos"... c'est un jugement qui sort d'où??? de ton cerveau humain incapable d'appréhender ces notions là sans y coller sa subjectivité. Si tu penses que les mathématiques sont de l'ordre de la croyance et s'apparente à une déification.. c'est que tu n'arrives pas à te figurer une pensée sans Dieu... Je n'en suis pas responsable. |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 12 Avr 2017, 07:49 Mer 12 Avr 2017, 07:49 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- salamsam a écrit:
Si tout n'étais que hasard, ce serait le chaos. Tout ne peux s'expliquer par le fameux dieu du hasard ou des probabilités auxquels croient les athées. Et une série de numéro en lancant des dés ne prouve rien, ni sur le destin, ni sur le hasard.
Mais peut être n'as tu pas ouvert ce topic par hasard, peut être étais tu destiné à l'ouvrir. 
Il n'est pas question de destin, ni d'expliquer "tout"... mais de notre manière d'appréhender le hasard.
Si.... cette série de lancés de dés prouve que notre jugement est totalement à côté de la plaque quand il s'agit de hasard...
Donc ta phrase "si tout n'était que hasard, ce serait le chaos"... c'est un jugement qui sort d'où??? de ton cerveau humain incapable d'appréhender ces notions là sans y coller sa subjectivité.
Si tu penses que les mathématiques sont de l'ordre de la croyance et s'apparente à une déification.. c'est que tu n'arrives pas à te figurer une pensée sans Dieu... Je n'en suis pas responsable. Ce que je veux dire c'est qu'il est impossible de savoir si le hasard même existe et que si le monde était régit par le hasard, la vie ne pourrait s'installer durablement. Je n'ai jamais dit ce que tu me prètes sur les mathématique, mais il est certain que celui qui croit pouvoir tout expliquer à partir des mathématiques, déifie les mathématiques. Les mathématiques par exemple, ne peuvent determiner si la série de résultat que tu as obtenu en lancant les dés, est le fruit du hasard ou du destin. Comment savoir si tu aurais put obtenir une autres série de résultat à l'instant où tu as lancé les dés ? Il faudrait une machine à remonter le temps. Et non, tu n'es pas responsable de ma croyance en Dieu, fort heureusement.  |
|   | | Cyril 84
Moderateur


 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 12 Avr 2017, 23:56 Mer 12 Avr 2017, 23:56 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- Bonjour,
Je vous propose de réfléchir à notre rapport au hasard.
Je souhaite montrer que nous ne sommes pas objectifs dans notre rapport au hasard.
En effet, notre intellect nous conduit à rechercher un sens, des solutions à tout. Les faits sont pour nous des données que nous analysons pour leur chercher un sens. Il se trouve que nous sommes également dépassés par ce schéma intellectuel... car nous cherchons un sens à ce qui n'en a pas nécessairement. Aujourd'hui lorsque je marchais 2 invités se sont posés sur mon doigt sans que je ne m'en aperçoive : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quelle probabilité y-avait-il que cela se produise ?Cela ne m'est jamais arrivé. Ils ont quand même choisi mon doigt comme "alcôve" pour se reproduire !Et comble de la coïncidence, cela se passe le lendemain de l'ouverture de ce sujet... |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Jeu 13 Avr 2017, 00:24 Jeu 13 Avr 2017, 00:24 | |
| - salamsam a écrit:
- emmanuelle78 a écrit:
Il n'est pas question de destin, ni d'expliquer "tout"... mais de notre manière d'appréhender le hasard.
Si.... cette série de lancés de dés prouve que notre jugement est totalement à côté de la plaque quand il s'agit de hasard...
Donc ta phrase "si tout n'était que hasard, ce serait le chaos"... c'est un jugement qui sort d'où??? de ton cerveau humain incapable d'appréhender ces notions là sans y coller sa subjectivité.
Si tu penses que les mathématiques sont de l'ordre de la croyance et s'apparente à une déification.. c'est que tu n'arrives pas à te figurer une pensée sans Dieu... Je n'en suis pas responsable.
Ce que je veux dire c'est qu'il est impossible de savoir si le hasard même existe et que si le monde était régit par le hasard, la vie ne pourrait s'installer durablement.
Je n'ai jamais dit ce que tu me prètes sur les mathématique, mais il est certain que celui qui croit pouvoir tout expliquer à partir des mathématiques, déifie les mathématiques. Les mathématiques par exemple, ne peuvent determiner si la série de résultat que tu as obtenu en lancant les dés, est le fruit du hasard ou du destin. Comment savoir si tu aurais put obtenir une autres série de résultat à l'instant où tu as lancé les dés ? Il faudrait une machine à remonter le temps.
Et non, tu n'es pas responsable de ma croyance en Dieu, fort heureusement.  Savoir si le hasard existe? En tout cas le hasard répond aux règles mathématiques de probabilités??? Quand tu lances un dé, cela répond aux règles des proba, donc comment peut on dire que cela n'existe pas? Fais l'expérience suffisamment de fois et tes résultats correspondront à ce qui est mathématiquement attendu.. A moins que dieu soit une formule de mathématiques je ne vois pas. Même les maths c'est pas correct dans la pensée musulmane ou je rêve? Je suis étonnée, je dois dire. Comment acceptes tu de te servir de la technologie sans admettre les savoirs qui la permette? @ Cyril  J'adore... c'est tout à fait ce que je voulais illustrer... C'est tout de suite classé dans remarquable, extraordinaire..... moi la 1ere je vais porter toute mon attention sur ces "bêtes à bon dieu".... Je vais me connecter "spirituellement". Mais si on me demande d'analyser... ben c'est la saison de la reproduction des coccinelles, (il y en a plus ces derniers temps, non? j'ai l'impression que le recul des pesticides commence à faire son effet, et vu le nombre de points, il est possible que ce soit issu d'élevage... beaucoup utilisé dans la lutte biologique)... et elles volent souvent ensemble pendant la copulation et se posent sur le 1er support venu. Probabilité élevée (c'est relatif hein  ) C'est quand même courant de se retrouver avec une coccinelle sur soi non? enfin moi c'est "assez" souvent... en train de copuler, j'ai déjà vu... sans vouloir casser l'ambiance hein... mais perso à chaque fois je trouve que c'est extraordinaire quand même hein 
Dernière édition par emmanuelle78 le Jeu 13 Avr 2017, 00:29, édité 2 fois |
|   | | nollaig

 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Jeu 13 Avr 2017, 00:25 Jeu 13 Avr 2017, 00:25 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- Exemple:
lancons 10 fois de suite un dé.... et notons la série obtenue:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 4 4 2 3 4 1 5 6
est ce qu'une des 2 séries vous parait plus probable que l'autre?
On ne pourra s'empêcher de trouver la 1ere série bien plus improbable que la 2eme... en direct, on sera époustouflé par cette répétition... se dire qu'il n'y a pas de hasard... y chercher un sens... y voir une forme transcendance... cela crée même une certaine excitation intellectuelle tant cet atypie est peu probable!!
Pourtant, il y a strictement les mêmes chances de tomber sur la 1ere série que sur la 2eme. La 2eme série est donc tout autant atypique et peu probable. Les 2 avaient très peu de chances de se produire, mais pourtant c'est arrivé.
Mais même en le sachant, je suis sûre que vous continuez à trouver que cette série de 1 est tout de même extraordinaire..... C'est difficile de se défaire de nos schéma mentaux. C est compréhensible . Car supposons que la liste des résultats sot une liste non ordonnée . Alors dans ce cas , la seconde liste est plus probable que la première liste. Si on voit les listes des résultats comme ordonnées , la liste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 et la liste 5 6 4 4 2 3 4 1 5 6 sont équiprobable Mais si les liiste ne sont pas ordonnée , alors les probabilités reviennent à dire ( probabilité d avoir 10 fois 1 ) vs ( probabilité d avoir 2 fois 5, 2 fois 6 , 3 fois 4 , 1 fois 1 , 1 fois 2 , 1 fois 3 ) Et ( probabilité d avoir 2 fois 5, 2 fois 6 , 3 fois 4 , 1 fois 1 , 1 fois 2 , 1 fois 3 ) est supérieur à ( probabilité d avoir 10 fois 1 ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ps: l'ordonnancement vient des hommes et le choix de poser la question en regardant les listes comme ordonnées ou non dépend du mathématicien |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 15:49 Mar 30 Mai 2017, 15:49 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Texte émanant de l'association "connaitre" association foi et culture scientifique. Je vais diviser le texte en 4 parties car très long... Mais j'adjoins tout ceux qui m'objectent que le hasard ne peut être à l'origine de la vie... de l'univers... de lire et d'argumenter ou contre argumenter sur cette base. mais qu'est ce que le hasard qui est si rejeté?? - Citation :
- Hasard
Georges Armand
Cette réflexion a pour but de définir de façon précise « le hasard » et montrer, entre autre question, que l’évolution du système Terre Vie est le résultat de nombreuses interactions entre différents composants ou systèmes ayant des constantes de temps extrêmement différentes.
Hasard, aléatoire
Le mot arabe az-zahr, qui signifie le dé, est passé dans la langue espagnole sous la forme azar puis s'est transformé en français en hasard. Du latin nous est
arvenu le mot aléa qui, primitivement, signifiait aussi jeu de dés. D'aléa dérive l'adjectif aléatoire caractérisant un événement, une situation comportant une part importante d'incertain, d'imprévu. De leur signification originelle commune, ces deux mots ont conservé dans l'usage usuel, aujourd'hui, un sens voisin qui les fait considérer comme des synonymes.
Toutefois le mot hasard a été et est toujours utilisé pour spécifier des jeux dans lesquels les qualités, les intentions ou les actions des joueurs sont inopérantes : jeu de dés, loterie, roulette... Mais aussi son usage s'est étendu pour caractériser un événement ou une série d'événements auxquels l'observateur attribue deux caractères essentiels : l'imprévisibilité et la non signification. A ce niveau plus abstrait le mot aléa lui devient synonyme.
Événements passés
En affirmant qu'un événement, apparu dans le passé, est survenu au hasard, nous ne pouvons pas vouloir dire qu'il était imprévisible puisque cette qualité ne s'applique qu'à une occurrence se situant dans l'avenir. Par contre nous voulons dire que cet événement n'est pas signifiant. En effet nous affirmons implicitement, en disant cela, que nous ne pouvons déceler aucune cause, aucune influence de paramètres connus ou inconnus ou aucune intention ou action humaine qui auraient pu provoquer son apparition. Tout au plus, pouvons-nous dans certain cas, reconstituer une conjonction de circonstances, souvent indépendantes les unes des autres, concourant à la réalisation de cet événement.
Événements futurs
Il est clair que lorsque nous parlons d'un événement futur, le caractère de non signification mentionné ci-dessus est inclus dans l'affirmation qu'il peut survenir au hasard. Mais alors s'ajoute à cette non-signification première, le caractère d'imprévisibilité absolu. En conséquence l'on ne peut agir en vue de favoriser ou contrecarrer sa réalisation. Nous sommes impuissant car cette réalisation n'est déterminée à l'avance par aucune cause, par l'influence de paramètres sur lesquels nous pourrions agir. En ce sens le hasard s'oppose au déterminisme qui implique qu'à un ensemble de causes doit correspondre dans le futur la réalisation certaine d'un ou plusieurs événements.
Le hasard mythifié !
Ceci étant précisé il faut remarquer que nous avons tendance à attribuer, souvent abusivement, un caractère aléatoire à des événements survenant dans la vie courante.
Survenant donc au hasard, selon nos critères d'appréciation, nous les chargeons d'affectivité en les classant en événements favorables ou défavorables. Nous dirons alors que nous avons eu "de la chance" ou "de la malchance". Beaucoup d'expressions communes font état de cette charge subjective comme par exemple "le hasard fait bien les choses" ou inversement "c'est un coup du sort". L'on sent bien à travers ces deux locutions, choisies comme exemplaires, que l'on passe insensiblement de la constatation du caractère aléatoire de l’événement à la mythification de la "cause", le hasard. Il en résulte une sorte de personnalisation de celui-ci, attitude qui relève de l'animisme au sens de "mettre une âme dans". De là à accorder à l'aléatoire un statut d'entité, de cause agissante il n'y a qu'un petit pas. S'il est franchit l'on redonne alors sens à ce qui d'après notre définition n'en a pas, mais un sens auréolé d'ésotérisme lié au fait que cette cause efficiente est inconnaissable, inaccessible. A ce point il pourrait devenir avantageux de se la rendre favorable "de conjurer le sort".
Hasard et probabilités
Tous les jeux de hasard sont justiciables d'un traitement mathématique, en termes, cela va de soi, de chances ou chance est ici un nombre et non pas le mythe auquel nous venons de faire allusion. Afin d'éviter toute confusion nous utiliserons le mot probabilité en lieu et place de chance. La probabilité d'apparition d'un événement a une définition bien précise. Elle est égale au rapport du nombre de cas favorables relatifs à l'événement, au nombre total de cas possibles. Par exemple la probabilité d'apparition du nombre 4, en jouant avec un dé, est d'après notre définition 1/6. Une probabilité est donc un nombre compris entre 0 et 1. A ces deux nombres correspond respectivement une certitude de non apparition et de réalisation.
Aléatoire et réalité
Notre intention n'est pas d'exposer ici, tant soit peu, la théorie des jeux. Mais de montrer et d’analyser la démarche des scientifiques qui utilisent les catégories de
l'aléatoire en vue de décrire la réalité étudiée. Est-ce par commodité, par nécessité ou comme certains le disent est-ce un des caractères fondamentaux de la réalité? C'est une question qui mérite attention et à laquelle nous allons tenter de répondre maintenant. Bien entendu il faudra se garder de toute dérive mythique que nous avons essayé de caractériser cidessus. Les scientifiques eux- mêmes ne sont pas à l'abri d'une telle dérive lorsqu'ils sont à la recherche du sens. Le hasard, allié il est vrai à la nécessité, a été promu au statut de cause efficiente par un scientifique de grande renommée... Mais avant d'aborder cette question, il est nécessaire de préciser deux notions importantes en vue de clarifier le débat.
Dernière édition par emmanuelle78 le Mar 30 Mai 2017, 16:55, édité 6 fois |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 15:50 Mar 30 Mai 2017, 15:50 | |
| suite - Citation :
Phénomènes indépendants ou corrélés
La première est relative à la définition du hasard. Nous allons préciser celle-ci en distinguant deux catégories de phénomènes aléatoires. Considérons un
phénomène pouvant conduire à l'apparition de l'événement A ou à sa non apparition (non A), puis quelques instants plus tard, ou simultanément dans des lieux différents, à l'apparition de l'événement B ou non B. Si la probabilité de voir se réaliser B ou non B ne dépend pas de la probabilité de réalisation de A ou de non A, ces deux événements se produisent indépendamment l’un de l’autre. Ce qui signifie qu'il n'existe aucun lien, aucune interaction si faibles soient-ils, qui puisse provoquer B ou non B du fait de la réalisation de A ou de non A. Ils ne sont pas corrélés et entre eux la corrélation est nulle L'on ne peut donc trouver une liaison, une signification qui leur soit commune. Nous dirons que le processus qui les produit est un processus aléatoire pur ou au hasard. Les jeux de hasard sont des
exemples de tels processus. Le jeux de pile ou face est un des plus simples: au second lancé de la pièce la probabilité d'avoir pile ou face est toujours 1/2 quel que soit le résultat du premier lancé. Le « souvenir » de ce résultat est effacé. Mais si la probabilité d'apparition de B ou de non B dépend, même faiblement, de celle de A ou de non A, les deux événements ne sont plus indépendants mais sont corrélés. Ou exprimé de façon anthropomorphique afin de faciliter la compréhension, B se « souvient » du fait que A est apparu ou non. Il existe donc un lien entre ces deux événements, liaison qui signifie que nous pouvons rechercher la nature de celle-ci, qui est, elle, le lieu d'une signification. Le processus qui génère ces événements est dit aléatoire et doit être différencié d'un processus aléatoire pur ou au hasard qui, lui, produirait des événements non corrélés. Dans ce cadre l’on définit des distributions de probabilité d’une ou plusieurs variables représentant un ou plusieurs événements. Ces distributions peuvent être :
- indépendantes du temps ; il s’agit alors d’un processus stationnaire.
- dépendantes du temps représentant alors un processus évolutif.
- dépendante du temps avec « mémoire » des temps antérieurs.
Par exemple la distribution de probabilités au temps t1 dépend de celle relative au temps t0. De tels processus sont dits stochastique ou Markovien.
En corollaire, il s'ensuit qu'une description d'un phénomène en termes de probabilité ne signifie pas qu'il se produise au hasard. Encore faut-il vérifier, avant d'affirmer cela, que les événements qui peuvent en résulter sont bien non corrélés ou indépendants les uns des autres.
Particules indiscernables
La seconde nous amène à remarquer que de très nombreux phénomènes naturels sont interprétables en termes de théorie des processus aléatoires, notamment lorsque l'on étudie l'évolution d'un système macroscopique en partant de ses composants microscopiques (électron, proton, neutron, atome...).
L'on est alors conduit à considérer ces composants microscopiques comme étant indiscernables. Ceci signifie qu'il est impossible de distinguer l'une de l'autre deux particules de même type, deux particules ayant les mêmes caractéristiques. L'on ne peut ainsi distinguer un électron d'un autre électron, ou un proton d'un autre proton... Il en est de même d'atomes de cuivre entre eux, de molécules d'oxygène entre elles... Le très grand nombre de particules composant le système impose
nécessairement une description de ce système en termes de processus aléatoire.
Gaz parfait : molécules indépendantes
Considérons le modèle de gaz parfait. Dans ce modèle il n'y a pas de forces, pas d'interaction agissant entre chaque molécule. Nous isolons par la pensée l'une d'entre elle, par la pensée seulement car elles sont indiscernables. La vitesse de cette molécule change de grandeur et de direction à tout instant, lors des chocs entre molécules ou sur la paroi du récipient. Au cours du temps direction et grandeur des vitesses sont distribuées au hasard car la probabilité que cette molécule ait une vitesse donnée à un instant donné ne dépend pas de la vitesse qu'elle avait aux instants précédents, ni de celles qu'avaient ou ont ses "consoeurs". Ces considérations, jointes au fait que le nombre de molécules du volume gazeux ainsi que son énergie interne sont fixés, permettent de calculer la probabilité de chaque vitesse possible. Ceci étant, la description au hasard ne signifie pas qu'il joue un rôle moteur mais que les molécules sont et restent au cours du temps indépendantes les unes des autres. Ceci était d'ailleurs contenu dans le modèle, au départ de notre étude, puisque nous avons supposé qu'aucune force n'agissait entre elles. Il serait donc plus correct de dire: du fait de l'absence de forces d'interaction entre molécules, celles-ci sont indépendantes les unes des autres et en conséquence leurs vitesses sont distribuées au hasard.
Ce modèle, très simple, permet de retrouver la loi de Mariotte prescrivant que les produits, respectivement de la pression par le volume et de la température par une constante adéquate, sont égaux. L’on sait que cette loi est valable lorsque la température du gaz est nettement plus élevée que la température critique, dépendante de la nature de celui-ci.
Un ivrogne...
Un autre exemple suggestif sera considéré maintenant. Il s'agit du problème de la marche au hasard qui s'applique, entre autre question, à la problématique de l'ivrogne qui sortant du cabaret voudrait retrouver son domicile. Cet exemple nous permettra de progresser et de nous détendre un peu au cours d'une réflexion qui, peut-être, est un peu austère.
marchant au hasard...
Considérons donc un homme sortant d'un débit de boisson et ayant un taux d'alcoolémie tel qu'il puisse encore marcher sans être capable de distinguer la direction qu'il doit prendre pour rejoindre son domicile. Il marche en titubant et chaque pas qu'il fait est dirigé au hasard. Nous supposons que la porte du cabaret donne sur une vaste place. Ces considérations ne sont pas irréalistes! ... Il se déplace en suivant une ligne brisée, d'aspect très chaotique et, après un certain temps, se trouve être en un point situé à une distance bien déterminée de son point de départ. Un observateur peut effectivement mesurer cette distance. Mais un observateur qui voudrait prévoir le chemin suivi ou le point atteint après un temps donné ne peut le faire qu'en terme de probabilités. L'on calcule en effet, sans difficultés particulières, la probabilité que l'homme puisse se trouver en un point quelconque de la place et ceci en fonction du temps. L'on démontre ainsi que le point où la probabilité est la plus élevée est justement... la porte du cabaret! Cercle vicieux dont il est difficile de sortir! ...
En fait cette marche au hasard ne produit rien de nouveau puisque l'ivrogne a les plus grandes "chances" (ou "malchances") de se retrouver dans le débit de
boisson dont il vient de sortir. ou avec un peu de lucidité Mais supposons maintenant que cet homme n'ait pas tout à fait perdu le sens de l'orientation et qu'il ait encore conservé une vague idée de la direction qu'il doit prendre. Les pas qu'il fera seront de temps à autre préférentiellement dirigés dans cette direction et, malgré le peu de lucidité qui lui reste, il pourra éventuellement se souvenir de la direction empruntée lors du pas précédent. L'orientation de ses pas n'est plus purement aléatoire, au hasard. Dans ces conditions sa trajectoire sera aussi une ligne brisée mais après un certain temps sera, en moyenne, orientée dans la direction qu'il souhaite... La probabilité d'atteindre un point quelconque est différente de celle considérée dans le cas précédent. Elle devient plus importante pour les points situés dans ou à proximité de la direction entrevue. Finalement l'homme a de grandes « chances » de se retrouver chez lui ... L'introduction d'une notion d'orientation, même vague, plus exactement l'introduction d'une probabilité un peu plus grande de réaliser un pas dans la bonne direction, permet l'apparition de nouveauté. L'homme peut sortir du cercle vicieux dans lequel il était enfermé auparavant.
Dernière édition par emmanuelle78 le Mar 30 Mai 2017, 16:49, édité 2 fois |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 15:51 Mar 30 Mai 2017, 15:51 | |
| - Citation :
Corrélations, des causes physiques
Au sens de l'orientation que notre ivrogne n'avait pas tout à fait perdu correspond dans les phénomènes naturels l'effet de forces, l'effet d'interaction entre particules... molécules... systèmes... qui orientent l'évolution vers ... La description de cette évolution est réalisée, le plus souvent en termes de probabilités. Mais alors celles-ci ne sont plus celles relatives au processus aléatoire pur ou au hasard, mais celles correspondant à des processus aléatoires dans lesquels des corrélations apparaissent. Les « causes » efficientes ne sont pas à rechercher dans le hasard mais bien plutôt du coté des quatre forces ou interactions fondamentales agissant dans notre Univers (Interactions ou forces forte, faible, électromagnétique et gravitationnelle).
Notons, en guise de remarque, que si l'évolution prévisible du système conduit à montrer qu'il tendra vers un état bien déterminé avec une probabilité égale à 1, nous pouvons être certain qu'il atteindra cet état. Le système est déterministe. Cette situation correspond à celle d'un homme qui, sortant du cabaret en pleine possession de ses facultés, a la ferme intention de regagner son domicile.
Particules en interaction
Une illustration simple de ce que nous venons d'énoncer consiste à introduire, dans le modèle de gaz parfait, les forces ou interactions agissant entre molécules. Leurs vitesses ne sont plus distribuées au hasard mais sont alors corrélées entre elles. De ce fait le volume gazeux peut se liquéfier dans certaines conditions de température et de pression. Sans ces forces le gaz ne se liquéfierait pas. L'on sait par expérience que tout gaz peut être liquéfié.
Particules indépendantes
Il existe toutefois des situations dans lesquelles les particules n'interagissent pas entre elles. Ce sont essentiellement des situations mettant en jeu des particules dont le « comportement » est décrit par la mécanique quantique.
Considérons une expérience simple, mais néanmoins expérience fondatrice de la mécanique quantique. En effet le concept de dualité onde-corpuscule formulé par Louis de Broglie en 1924, fut expérimentalement confirmé par l’observation du phénomène de diffraction des électrons (1929) et d’atomes d’hélium (1931) par un monocristal de nickel.
Dans cette expérimentation, nous envoyons un jet d'atomes d'hélium sur une surface dure, ayant la forme d'une « gaufre » régulière, à l'échelle de la dimension de ces atomes, la surface d’un monocristal métallique par exemple. Ils sont diffractés c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés dans des directions bien déterminées, avec une probabilité spécifique à chaque direction. Directions, dont le nombre est limité, et probabilités attachées sont calculables, notamment si l'on connaît la forme du « gaufrage »...
L'expérience prouve que dans tout phénomène de diffraction la particule (photon, électron, neutron, atomes d’hélium, néon, argon, molécule d’hydrogène) diffracte avec elle-même en interagissant avec le dispositif, pour l'atome d'hélium en interagissant avec la surface « gaufrée ». Diffracte avec elle-même signifie qu'au cours du processus il n'y a pas d'interaction entre particules elles-mêmes, entre atomes d'hélium, c'est à dire qu'ils sont au cours du phénomène indépendants les uns des autres. Ou exprimé autrement, l’onde « associée » à chaque atome, se « répand » dans toutes les directions permises.
De ce fait si nous plaçons un détecteur dans l’une de ces directions et effectuons une mesure, lors de cette mesure nous « transformons » l’onde en particule. Et nous constatons que le nombre d'atomes détectés dans chaque petit intervalle de temps est distribué au hasard. Mais au total, lorsque le nombre d'atomes mesuré est suffisamment grand, nous constatons qu'il est égal au nombre total d'atomes envoyés sur la surface multiplié par la probabilité de diffracter dans la direction choisie. Réciproquement, constatant que l'arrivée des particules dans chaque direction se produit de façon purement aléatoire, nous ne pouvons pas en conclure que le processus est dirigé par le hasard mais plutôt conclure qu'au cours de ce processus chaque particule interagit indépendamment de tout autre, avec le dispositif provoquant la diffraction. Ce « hasard » se retrouve comme étant à la base de tout phénomène décrit par la mécanique quantique. Toutefois lorsque la mesure porte sur un grand nombre de particules nous obtenons un résultat conforme aux différentes probabilités calculées. Au niveau macroscopique, des grands nombres, nous retrouvons le déterminisme.
Systèmes dissipatifs
Le Boléro de Ravel est une image musicale de tels systèmes : une phrase musicale est répétée de façon périodique tandis qu’à chaque période un nouvel instrument ajoute ses harmoniques, image de l’énergie ou de la matière fournies au système. L’intensité sonore croît jusqu’à un « écroulement » final dans une disharmonie, image d’une bifurcation. Il est regrettable que l’auteur n’ait pas poursuivi … par une nouvelle phrase musicale ce qui eut été l’image d’un nouvel état atteint par le système. Les systèmes dissipatifs chaotiques ont trois degrés de liberté ou plus, et sont dits « ouverts » c'est-à-dire qu’ils échangent de l’énergie ou de la matière avec le milieu qui leur est extérieur.
Le système Terre-Soleil ayant deux degrés de liberté est périodique. En considérant la Lune, un degré de liberté supplémentaire, l’on peut écrire les équations du mouvement de ces trois corps (déterminisme) mais on ne peut les résoudre. Le système devient encore plus complexe si l’on y introduit les planètes telluriques … et devient franchement chaotique. L’on observe qu’apparaissent trois périodes : 25800 ans pour la précession des équinoxes, 41.000 ans pour l’inclinaison de l’axe de rotation terrestre et 100.000 ans pour la forme de l’orbite autour du Soleil. En poussant les calculs (par ordinateur) l’on constate qu’après plusieurs millions d’années, temps dépendant des conditions initiales choisies, l’obliquité de l’axe de rotation terrestre pourrait atteindre des valeurs proches de 90° et varierait ensuite rapidement. L’atmosphère terrestre est un autre exemple : elle reçoit de l’énergie en provenance du Soleil ou en émet la nuit, est en interaction avec les terres émergées et les océans, et reçoit de la chaleur en provenance du milieu intérieur terrestre … Afin de prévoir le « temps » qu’il fera l’on est amené à
résoudre (par ordinateur) les équations d’évolution de ce système (déterministe) en partant des conditions de température, pression, humidité, vents …à un instant donné, dites conditions initiales. L’on constate que l’évolution de ce système dépend fortement de ces conditions. De ce fait l’on est obligés de considérer un ensemble de conditions initiales voisines et de calculer l’évolution du système en termes de probabilités, les prévisions devenant de plus en plus aléatoires au fil des jours, pour devenir impossible à partir d’un certain temps (15 jours, trois semaines ?).
Certaines réactions chimiques présentent les caractères des systèmes chaotiques lorsque la réaction est loin de l’équilibre. En de telles réactions des biomolécules peuvent être synthétisées. Ces exemples illustrent les propriétés des systèmes dissipatifs ou chaotiques, dont les interactions avec le milieu extérieur et entre ses différentes parties sont importantes : extrême sensibilité aux conditions initiales rendant possible leur évolution vers des états différents, et impossibilité de prévoir leur évolution au delà d'un certain temps caractéristique de chaque système. Ces deux propriétés sont d'ailleurs logiquement liées, la sensibilité aux conditions initiales rendant inopérante la prévision. Ces propriétés et notamment l'imprévisibilité au delà d'un certain temps, nous oblige à ne plus penser en termes de déterminisme strict. Et l'on pourrait se croire autoriser, à nouveau, à évoquer un hasard moteur en l'assimilant à un certain indéterminisme. Or il s'avère que le déterminisme ou son contraire ne sont pas, eux non plus, des causes efficientes mais sont en fait des propriétés caractéristiques que nous attribuons aux systèmes que nous étudions. Cet indéterminisme relatif est une des propriétés des systèmes dissipatifs provenant en dernière analyse des interactions entre ses divers composants et des contraintes auxquelles le système étudié est soumis, par le milieu extérieur. Interactions et contraintes qui provoquent l’évolution du système vers un ou des états nouveaux, des structures nouvelles, dont certains sont stables. Alors le système est productif de nouveauté.
Dernière édition par emmanuelle78 le Mar 30 Mai 2017, 16:50, édité 1 fois |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 16:49 Mar 30 Mai 2017, 16:49 | |
| suite et fin - Citation :
Le système Terre –Vie
Un vivant est un système ouvert qui prélève de l’énergie (matière, oxygène … ) dans son environnement afin de construire de l’ordre en son sein.
Il crée ainsi de la néguentropie, tandis qu’en rejetant les déchets de cette activité, il rejette dans l’environnement une quantité plus grande de désordre ou dit autrement d’entropie. Celle-ci est absorbée par le système Univers qui, étant en expansion, offre un « volume » de plus en plus grand pour accueillir
ce surplus de désordre.
Ainsi il n’y a pas d’impossibilité physique à ce que différents systèmes se complexifient, présentant un ordre plus élevé que la somme de ses composants.
En particulier, il n’y a pas d’impossibilité à ce que le « Vivant » apparaisse et évolue en se complexifiant naturellement, soit sans faire appel à une quelconque intervention extérieure. Ceci étant précisé, ce système est évidemment l’un des plus complexes que nous étudions. Il est le lieu d’interactions importantes dans et entre sous systèmes, dont les évolutions propres s’étalent sur des échelles de temps géologiques très différentes. Devant la difficulté, voire l’impossibilité d’une
description exhaustive de cette évolution, l’on place dans la sélection naturelle les interactions que la Terre, le milieu naturel … exercent sur le vivant. Il n’est pas étonnant alors que l’on fasse appel au hasard considérant le jeu des possibles que peut explorer le vivant, ignorant alors les nombreuses interactions (forces) qui concourent à le construire. Un exemple emblématique va permettre de clarifier cette question.
Concernant l’origine de la vie, les scientifiques s’accordent pour penser que l’étape décisive est l’apparition du « premier gène d’ARN ». Constitué de 4 nucléotides différents, le nombre de possibilités de produire une chaîne de n nucléotides est 4n . Compte tenu de ce nombre et de la nécessité de réplication avec un taux l’erreur acceptable, les biologistes sont conduits à attribuer à cet ARN premier une taille de 35 nucléotides. Il lui correspond 1,18 1021 configurations possibles. Par conséquent la probabilité d’apparition de la « bonne » configuration, par hasard pur, est de 8,5 10-22 … soit une impossibilité pratique. Argument qui peut être exploité en faveur du « dessein intelligent ».
Pour se constituer ces configurations ont prélevé les atomes dans leur environnement et ceux-ci se sont assemblés sous l’effet de l’interaction électromagnétique
liaison chimique). S’il est douteux que toutes les configurations fussent réalisées, il est loisible de penser que le nombre de configurations explorées fut limité par la nécessité que celles-ci soient en un état stable ou métastable d’énergie minimum et réplicables avec un taux d’erreur minime. Ensuite et concomitamment il y aurait eu optimisation sélective par l’environnement. Par exemple n’auraient pu résister que les configurations capables de transformer l’énergie des UV en chaleur sans être détruits.
S’il en ainsi le « premier » ARN serait apparu « naturellement » par le jeu des nombreuses interactions. Un autre exemple concerne les mutations ponctuelles lors de division cellulaire. Si p est la probabilité qu’une mutation se produise lors de la division d’une cellule, la probabilité P^n pour qu’au moins une mutation se produise au cours de n divisions est donnée par l’expression : P^n = 1 – (1 – p)^n . En attribuant à p la valeur 1/(3.10^9 ) et fixant P^n = 999/1000, l’on détermine n = 20.10^9 . Il faut donc 20 milliards de division cellulaire pour être quasi certain qu’il se produise au moins une mutation.. « ce chiffre peut paraître énorme mais, en fait, il équivaut au nombre de division de cellules souches qui ont lieu dans notre moelle osseuse en l’espace d’environ deux heures au cours du renouvellement des globules rouges »
. Indépendamment de toute signification relative à l’évolution l’on doit remarquer que le hasard est le concept permettant le calcul de P^n . Cela est de l’ordre de la nécessité car nous sommes obligés de considérer un nombre considérable d’événements qui n’ont pas de liaison entre eux : à priori une mutation lors d’une division dans une cellule n’a pas d’influence sur le comportement des autres. Mais ce qui détermine la division et la mutation, les interactions entre composants de la cellule, les mécanismes, ne sont pas à priori concevable dans le concept du hasard. Et c’est dans la valeur de p que nous plaçons les effets de ces mécanismes.
Nous sommes à mêmes de décrire les différentes étapes balisant l’évolution de ce système. Et différentes « théories » ont été proposées explicitant les mécanismes mis en jeu. Certaines font appel au hasard sans préciser d’ailleurs ce que ce concept recouvre. S’agit-il du hasard pur au sens donné plus haut à cette expression ? Alors il n’y aurait pas de liaison dans et entre l’évolution des sous-systèmes, et ceux-ci ne produiraient aucune nouveauté. Il s’agit plutôt de considérer les interactions entre ceux-ci et de parler en termes d’aléatoire, de corrélation, la complexité du système rendant l’analyse extrêmement difficile. Il n’y a donc pas lieu d’invoquer le hasard pur si ce n’est, en définitive, pour cacher notre ignorance ou notre impuissance à expliciter le détail des mécanismes mis en jeu au cours de cette évolution. Alors faut-il placer dans les lieux de notre ignorance le « pilotage ou l’effet » d’un dessein intelligent ?
|
|   | | rosarum

 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 18:58 Mar 30 Mai 2017, 18:58 | |
|  c'est très intéressant |
|   | | Thedjezeyri14

 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 20:04 Mar 30 Mai 2017, 20:04 | |
| Merci pour ce pratage excellent chere Emannuelle. |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 21:53 Mar 30 Mai 2017, 21:53 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- Exemple:
lancons 10 fois de suite un dé.... et notons la série obtenue:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 4 4 2 3 4 1 5 6
est ce qu'une des 2 séries vous parait plus probable que l'autre?
On ne pourra s'empêcher de trouver la 1ere série bien plus improbable que la 2eme... en direct, on sera époustouflé par cette répétition... se dire qu'il n'y a pas de hasard... y chercher un sens... y voir une forme transcendance... cela crée même une certaine excitation intellectuelle tant cet atypie est peu probable!!
Pourtant, il y a strictement les mêmes chances de tomber sur la 1ere série que sur la 2eme. La 2eme série est donc tout autant atypique et peu probable. Les 2 avaient très peu de chances de se produire, mais pourtant c'est arrivé.
Mais même en le sachant, je suis sûre que vous continuez à trouver que cette série de 1 est tout de même extraordinaire..... C'est difficile de se défaire de nos schéma mentaux. Les chances sont absoluments égales dans les 2 cas si on doit avoir pour la deuxième série, obligatoirement un 5, suivi obligatoirement d'un 6, puis obligatoirement d'un 4 puis à nouveau d'un 4 obligaoire, etc. en reproduisant fidèlement la série proposée. Spontanément on fait un raccourci et on traduit mentalement la deuxième série par "chiffres quelconques dans le désordre", je n'ai pas de calcul mathématique à proposer mais je pense que tirer 10 fois le 1 avoisine l'impossible tandis que tirer 10 fois un peu n'importe quoi est ce qu'on vit dans un jeu de dé ordinaire c'est ce qui nous trouble dans le raisonnement. |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 30 Mai 2017, 23:07 Mar 30 Mai 2017, 23:07 | |
| - cailloubleu a écrit:
- emmanuelle78 a écrit:
- Exemple:
lancons 10 fois de suite un dé.... et notons la série obtenue:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 4 4 2 3 4 1 5 6
est ce qu'une des 2 séries vous parait plus probable que l'autre?
On ne pourra s'empêcher de trouver la 1ere série bien plus improbable que la 2eme... en direct, on sera époustouflé par cette répétition... se dire qu'il n'y a pas de hasard... y chercher un sens... y voir une forme transcendance... cela crée même une certaine excitation intellectuelle tant cet atypie est peu probable!!
Pourtant, il y a strictement les mêmes chances de tomber sur la 1ere série que sur la 2eme. La 2eme série est donc tout autant atypique et peu probable. Les 2 avaient très peu de chances de se produire, mais pourtant c'est arrivé.
Mais même en le sachant, je suis sûre que vous continuez à trouver que cette série de 1 est tout de même extraordinaire..... C'est difficile de se défaire de nos schéma mentaux.
Les chances sont absoluments égales dans les 2 cas si on doit avoir pour la deuxième série, obligatoirement un 5, suivi obligatoirement d'un 6, puis obligatoirement d'un 4 puis à nouveau d'un 4 obligaoire, etc. en reproduisant fidèlement la série proposée.
Spontanément on fait un raccourci et on traduit mentalement la deuxième série par "chiffres quelconques dans le désordre", je n'ai pas de calcul mathématique à proposer mais je pense que tirer 10 fois le 1 avoisine l'impossible tandis que tirer 10 fois un peu n'importe quoi est ce qu'on vit dans un jeu de dé ordinaire c'est ce qui nous trouble dans le raisonnement.
le truc aussi c'est que la 2eme série nous parait pas aussi improbable que la série de 1.. alors qu'elle l'est. c'est juste que nous attachons subjectivement plus de valeur à l'une qu'à l'autre. La probabilité d'avoir une suite d'une même face se calcule... elle est faible mais pas impossible. (les pro des maths pourront nous le calculer) Citation dont j'ai oublié l'auteur: "Il est impossible de l'improbable n'arrive jamais." |
|   | | Roger76
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 00:22 Mer 31 Mai 2017, 00:22 | |
| Je suis de formation maths physique chimie, en maths c'est surtout les techniques mathématiques appliquées à la physique qui m'ont intéressé, imaginaire généralisé sous ensemble flous et autres élucubrations qui faisaient sourire certains mathématiciens de renom mais qui depuis ont trouvé de nombreuses applications industrielles, freinage ABS, machines à laver, robots, soudure et j'en méconnais.
La théorie des systèmes que j'ai enseignée était prise our un amusement, aujourd'hui on abuse du terme dans tous les domaines en le vulgarisant.
Par contre la statistique ne m'a pas intéressé, ou je n'ai pas eu l'occa sion de m'y mettre.
Ce que tu dis du tirage aléatoire est vrai, la probabilité de trer dix fois le même chiffre est la même que de tirer la suite 12345...
Cela se vérifie en théorie sur un nombre quasi infini de tirages...
Pour ce qui est des corrélations j'en reviens à l'analyse systématique, où tout systyle es un sous-système réagissant avec les autres sous-systèmes du système (ce n'est pas le cas des ensembles et sous-ensembles classiques, qui contiennent ou non des élément possédant une propriété caractéristique , en systémique il n'y a que des composants)
Les spécialistes traitent maintenant les humais etleurs sociétés comme des 'écosystèmes".
Pour les corrélations je suis réservé, à manier avec prudence pour identifier les facteurs..
Un Préfet dans le Midi avait noté une étroite corrélation entre la consommation de bière et les incendies de forêt.
Pour lutter contre ces incendies il a pris un arrêté préfectoral : interdire la consommation de bière en été...
J'avais réuni quelques docs où l'analyse statistique donnent des résultats qui déroutent le sens commun.
Par exemple la probabilité dans une classe d'élèves qu'au moins deux élèves aient leur anniversaire le même jour est bien plus élevée qu'on ne le pense... |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 00:27 Mer 31 Mai 2017, 00:27 | |
| - Roger76 a écrit:
Par exemple la probabilité dans une classe d'élèves qu'au moins deux élèves aient leur anniversaire le même jour est bien plus élevée qu'on ne le pense... Oui j'avais vu ça!!! Ca m'avait beaucoup amusé! je pense que notre esprit biaise notre rapport aux proba... |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 00:30 Mer 31 Mai 2017, 00:30 | |
| Un autre article... le précédent était d'un théologien. Là c'est de la philosophie: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Citation :
- Évolution et hasard
Jean Gayon
UFR de philosophie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Introduction
Il n’existe pas et il n’a jamais existé une théorie biologique ayant prétendu expliquer l’évolution des espèces par le hasard, sans autre spécification. Une telle idée n’apparaît jamais que dans un contexte polémique, où des savants, philosophes ou théologiens qui n’aiment pas telle ou telle théorie de l’évolution, la lui imputent. Ceci ne veut pas dire que la notion de hasard n’intervient pas dans l’explication des phénomènes évolutifs. Elle y a presque toujours été présente, notamment dans les versions successives de l’approche darwinienne de l’évolution.
La notion de hasard est notoirement ambiguë, en sorte qu’il n’y a pas grand sens à parler de manière générale du rôle du hasard dans l’évolution, comme on le fait trop souvent. Deux conditions doivent être remplies pour que la question de la relation entre hasard et évolution ait un sens. Il faut en premier lieu préciser en quel sens on entend le mot « hasard ». Il faut par ailleurs préciser les contextes scientifiques où les diverses notions du hasard sont utilisées. Faute de satisfaire ces deux exigences, analytique et contextuelle ou, si l’on préfère, philosophique et scientifique, les déclarations générales sur le rôle du hasard dans l’évolution biologique sont stériles.
Je soutiens que dans la théorie de l’évolution contemporaine on rencontre trois significations possibles du mot « hasard » : la chance, l’aléatoire, et la contingence par rapport à un système théorique donné. Ces trois termes — chance, aléatoire, contingence en contexte explicatif — sont souvent confondus les uns avec les autres, ainsi d’ailleurs qu’avec celui de « fortuit ». « Fortuit » est en fait l’adjectif qui correspond le mieux au substantif « hasard » dans la langue française, l’adjectif « hasardeux » ayant en pratique un sens trop particulier pour refléter la variété sémantique qu’enveloppe le mot « hasard ». « Fortuit » vient du latin fors, qui n’est pas un équivalent rigoureux du français « hasard », car il exprime l’idée de chance, c’est-à-dire l’un des sens possibles du terme français moderne de hasard. Le mot « hasard » a lui-même une origine arabe. Il vient de az-zahr, qui désigne littéralement le jeu de dés. L’origine arabe ne fournit donc pas un point de repère sûr, car il renvoie lui aussi à un sens particulier du terme français moderne de hasard, l’aléatoire. Par commodité, j’utiliserai les termes de hasard et de fortuit comme des termes génériques qui couvrent le même champ sémantique, et sont donc affectés des mêmes ambiguïtés.
Dans la première partie de cet article, je définirai les trois concepts de hasard que j’ai mentionnés. Dans la seconde, je les appliquerai aux principales sortes de phénomènes que la théorie évolutionniste moderne caractérise et explique comme étant des classes d’événements fortuits.
I. Trois sens du concept de hasard
1. Chance
Le sens le plus familier du mot « hasard » apparaît dans des contextes humains où quelque chose se produit de manière inattendue plutôt que comme effet d’un plan délibéré [1]. Imaginons par exemple qu’un jardinier, bêchant le sol de son verger en vue d’y planter un arbre, trouve un coffret de bijoux. Dire que le jardinier a trouvé « par hasard » les bijoux signifie ceci : « le jardinier a trouvé un objet hautement désirable en poursuivant un but tout à fait différent ». Dans ce contexte, la référence au hasard se comprend sur arrière-plan d’une notion de finalité. Cette acception du concept de hasard est la plus ancienne de toutes. C’est celle que l’on voit Aristote commenter dans sa Physique (II, 5). Dans ce texte fameux, Aristote explique que quelque chose résulte de la « fortune » (tuchê) ou du « hasard » (to automaton) lorsqu’un certain effet est accidentellement atteint « dans les faits qui se produisent en vue d’une fin », autrement dit lorsqu’une fin est atteinte sans avoir été la cause de l’effet produit. Dans le français courant, la meilleure expression de cette idée est rendue par les mots « chance » et « malchance », termes populaires qui disent parfaitement ce qu’ils veulent dire. En anglais, cette notion de hasard est rendue par le terme luck. Comme on le verra un peu plus loin, ce concept de chance, utile dans le domaine de la psychologie et de l’histoire humaine, peut être affranchi de son aspect intentionnel, et joue un rôle extrêmement important dans la théorie évolutionniste.
2. Événements aléatoires
Le mot « hasard » prend un sens plus technique lorsqu’on l’applique à des événements dont on ignore les causes au sens de conditions déterminantes, c’est-à-dire d’antécédents qui déterminent le cours d’événements en vertu de lois. Ce sens est plus récent, et peut être explicité de manière plus précise. On dit qu’un événement est aléatoire lorsque l’on sait que des événements sont réalisés en fonction de certaines classes de conditions définies, mais sans que l’on sache quelles conditions particulières sont réalisées dans un cas donné. On veut donc dire qu’il y avait plusieurs possibilités, mais que notre connaissance de l’événement ne nous permettait pas de prédire laquelle serait réalisée. Par exemple, lorsqu’au jeu de roulette la boule s’arrête sur une case donnée, nous avons de bonnes raisons de croire que cet événement dépend de conditions physiques définies, dont la nature et les effets pourraient être décrits de manière déterministe par un observateur-calculateur aux capacités illimitées. La notion de hasard au sens d’aléatoire est plus exigeante que celle de chance. Elle exige qu’on fasse une hypothèse sur ce qui, précisément, est aléatoire, et qu’on soit capable de démontrer qu’on est bien dans une situation aléatoire. La seule solution satisfaisante qu’on n’ait jamais trouvée à ce problème de circularité est de faire appel au calcul des probabilités, qui brise le cercle au moyen d’une solution opératoire. Un événement aléatoire est alors par définition un événement qui obéit à une loi de probabilité. On s’affranchit ainsi de la notion de cause. Un événement qui obéit à une loi de probabilité peut être le résultat d’un processus causal parfaitement déterministe. C’est le cas de la roulette, ou du jeu de dés, qui est d’ailleurs étymologiquement à l’origine du mot « aléatoire » en français, et de az-zahr en arabe. Mais une loi de probabilité n’implique pas nécessairement qu’une telle causalité existe. La mécanique quantique est un exemple classique de cette situation.
3. Contingence relativement à un système théorique
J’introduirai par un exemple le troisième sens du hasard que je retiens. Admettons qu’il existe un système théorique idéalisé consistant dans la « mécanique classique », c’est-à-dire, grosso modo, les lois de la dynamique de Newton, plus un certain nombre d’outils mathématiques tels que le calcul différentiel. Dans ce contexte théorique, on peut en principe inférer la position d’une planète du système solaire pour n’importe quel instant passé ou futur à condition de connaître la masse, la position et la vitesse de chacun des éléments du système solaire à un instant donné quelconque. Pour faire une telle prédiction, il est clair qu’il n’est pas suffisant de connaître les lois de Newton (ou une quelconque version plus sophistiquée de la mécanique classique). Outre des énoncés ayant valeur de lois, il faut aussi des énoncés de conditions initiales. Ces conditions initiales, c’est-à-dire les paramètres décrivant l’état réel du système solaire en un instant donné, sont dites contingentes relativement au système théorique que constitue la mécanique classique. La notion de contingence prend ici une signification opératoire précise. Il ne s’agit pas de dire qu’un événement ou une classe d’événements sont contingents en soi. Le même élément peut être contingent dans un certain contexte théorique, et ne l’être pas dans un autre contexte théorique. Par exemple, dans le contexte de la physique de Galilée, la valeur du coefficient g d’accélération est contingente par rapport à son système théorique (c’est-à-dire la loi de chute des corps), car elle ne peut être déterminée qu’empiriquement. Le système théorique de Galilée ne permet pas de la fixer. Mais dans le contexte de la physique de Newton, la valeur g n’est plus contingente. Elle peut être déduite à condition de disposer d’informations suffisantes sur la masse et la forme de la terre. En revanche, dans le système newtonien, la masse de la terre est un élément contingent. La forme ne l’est en revanche pas, car c’est une conséquence du système newtonien que la terre ait la forme d’un sphéroïde aplati aux pôles.
Cet exemple suggère un troisième sens possible du terme « hasard » dans les sciences de la nature. Certaines classes d’événements peuvent être dites fortuites dans la mesure où les événements ne sont pas prédictibles dans le cadre d’une certaine théorie, soit parce que la théorie ne permet pas du tout de prédire ces événements quelle que soit notre information empirique, soit parce que nous ne connaissons pas avec assez de précision les conditions initiales qui permettraient d’appliquer efficacement la théorie, soit encore parce que les calculs nécessaires sont trop complexes.
Les définitions des divers concepts de hasard que je viens de donner ne sont pas originales [2]. D’autres notions de hasard existent, chez ces auteurs et d’autres, que je n’ai pas considérées ici [3], notamment celle de hasard comme rencontre de séries causales indépendantes [4]. Les trois notions de hasard proposées me paraissent suffisantes pour analyser l’usage que les biologistes contemporains font du hasard dans leurs doctrines.
|
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 00:30 Mer 31 Mai 2017, 00:30 | |
| suite: - Citation :
II. Modalités du hasard en biologie de l’évolution
Dans la théorie évolutionniste moderne, la notion de hasard prend une importance capitale à cinq niveaux au moins : mutation, dérive génétique aléatoire, révolutions génétiques, écosystèmes, phénomènes macroévolutifs.
1. Mutation
Dans une perspective darwinienne, l’avantage conféré par une mutation est indépendant des causes physiques responsables de l’occurrence de la mutation. Ces causes consistent le plus souvent en des rayonnements, des facteurs chimiques, des événements de transposition ou de transduction virale qui altèrent le déroulement ordinaire de la recombinaison génétique. Ces facteurs expliquent l’occurrence d’une mutation, mais pas le fait qu’elle soit favorable. Lorsque le darwinien dit que les mutations se font au hasard, c’est seulement du point de vue de l’avantage ou désavantage qu’elle confère dans un environnement donné. La mutation est donc dite fortuite « au sens où la probabilité qu’elle se produise n’est pas affectée par son utilité virtuelle [5] ». Cette doctrine fondamentale est demeurée la même depuis Darwin, au vocabulaire près (Darwin ne parlait pas de mutations, mais de « variations »).
La notion de hasard qui intervient ici est apparentée à celle que j’ai caractérisée plus haut par le mot de chance. L’occurrence d’une mutation avantageuse (ou désavantageuse) est tout à fait comparable à ce qui arrive au jardinier qui trouve accidentellement des bijoux en bêchant son jardin. Le jardinier n’a pas trouvé de bijoux parce qu’il les cherchait, mais cette découverte peut avoir des effets très importants pour lui. Dans le cas des mutations génétiques, la situation conceptuelle est comparable, avec cette différence que nous n’avons pas besoin ici de nous référer à quoi que ce soit d’intentionnel. Les organismes individuels ne sont pas dotés d’une physiologie qui leur permet de faire des mutations favorables précises ; au mieux peuvent-ils parfois contrôler le taux de mutation. Mais une fois une mutation apparue, elle peut avoir des conséquences fonctionnelles suffisamment importantes pour affecter leurs chances de survie et de reproduction.
Notons enfin que si l’on envisage une mutation comme un phénomène récurrent dans une population, elle prend alors l’allure d’un phénomène déterministe et non plus fortuit du point de vue de l’évolution de cette population. C’est un autre problème.
2. Dérive génétique aléatoire
Ce processus est défini à l’échelle d’un locus dans une population mendélienne. Les populations réelles sont toujours finies, même si elles ont parfois de très grands effectifs. Il en résulte qu’il y a donc toujours un effet d’échantillonnage dans la distribution des fréquences géniques à chaque génération. La dérive génétique est un phénomène qui demande un traitement mathématique assez sophistiqué. On peut cependant en présenter l’esprit sur un cas simple. Considérons un gène existant sous deux formes alléliques, dans une population constituée de seulement deux individus, un mâle et une femelle. Admettons aussi que les deux individus soient hétérozygotes (Aa) pour ce locus. Si l’effectif de la population reste stable, c’est-à-dire si ces deux individus font deux enfants, la probabilité qu’ils fassent deux enfants homozygotes (soit AA, soit aa) est de 1/8 (c’est-à-dire 2 × 1/4). Il y a donc une assez forte probabilité que l’un des deux allèles soit définitivement perdu en une seule génération. Il faudra en fait peu de générations pour que l’un des deux allèles soit fixé dans cette petite population. Dans une grande population, les chances de perdre un allèle en une seule génération sont beaucoup plus petites, mais elles ne sont pas négligeables sur le long terme. La théorie de la dérive génétique aléatoire consiste à prédire les effets de l’effet d’échantillonnage aléatoire dans une population de taille quelconque et sur un grand nombre de générations. La dérive génétique est, comme on dit, un facteur d’évolution stochastique. L’idée de base est que la distribution de fréquence des gènes dans une génération donnée n’est jamais fixée de manière purement déterministe (par des facteurs tels que les mutations récurrentes, la sélection et la migration), mais doit toujours être décrite au moyen d’une loi de probabilité.
Le sens que prend le hasard dans la théorie de la dérive génétique aléatoire est le même que celui intervenant dans le jeu de la roulette ou dans les jeux de dés. C’est un hasard que nous ne savons nous représenter qu’au moyen d’une loi de probabilité. Il est aujourd’hui reconnu que ce facteur d’évolution a une extrême importance au niveau moléculaire. En fait, on admet aujourd’hui que c’est le facteur d’évolution qui est responsable de la majorité des fixations alléliques au niveau moléculaire (séquences nucléotidiques des chromosomes et séquences d’acides aminés des protéines). Notons au passage que la « théorie de l’évolution moléculaire par mutation et dérive aléatoire » (c’est le nom que lui a donné Motoo Kimura dans les années 1960) ne dit aucunement que l’évolution en général est neutre. Elle dit seulement que l’évolution est en grande partie neutre au niveau moléculaire. Notons de surcroît que cette notion de neutralité ne s’applique aux gènes qu’en un temps donné. Une substitution nucléotidique dans un gène peut très bien être neutre dans un contexte évolutif donné, et ne l’être plus dans un autre.
3. Révolution génétique
Ce concept, introduit en 1954 par Ernst Mayr, est lié à la notion de dérive aléatoire, mais il est différent, et il a aussi une signification différente du point de vue du hasard. La révolution génétique est une conséquence de la dérive génétique au niveau du génome. Lorsqu’une population voit ses effectifs réduits de manière dramatique, comme ceci arrive souvent à l’occasion d’un nouveau peuplement insulaire, ou dans un isolat périphérique, un certain nombre de locus sont fixés dans un état homozygote, du fait de la dérive génétique. Il en résulte que l’environnement génétique de nombreux autres gènes est modifié, et les valeurs sélectives d’un certain nombre d’allèles s’en trouvent modifiées. Cette situation est assez bien connue en génétique des populations expérimentales depuis l’étude menée par Georges Teissier en 1947 sur les variations de la fréquence du gène ebony dans une population stationnaire de Drosophiles, étude menée à une époque où l’expression de « révolution génétique » n’existait pas encore, mais qui en a fourni rétrospectivement une illustration expérimentale. D’assez nombreux autres cas ont été bien documentés depuis. Mais les révolutions génétiques, quoique extrêmement probables dans les populations naturelles, y sont très difficiles à documenter.
Comme l’a bien montré Maxime Lamotte [6], le genre de hasard qui intervient dans les révolutions génétiques est bien différent de celui associé à la dérive aléatoire. Les révolutions génétiques sont certes déclenchées par des événements de dérive aléatoire, mais leur caractère fortuit n’a pas le même sens. L’imprévisibilité n’est pas due à un phénomène stochastique (la dérive aléatoire, qui en est seulement une précondition), mais à la complexité des interactions des gènes entre eux et avec l’environnement externe. Ces interactions ont des effets déterministes sur l’évolution de la population par sélection naturelle, mais en pratique, il est très difficile au biologiste de prévoir l’évolution du système, en raison de la limitation de ses connaissances. Les théories dont dispose le biologiste de l’évolution pour comprendre les interactions génétiques sont insuffisantes à cet effet.
La notion de hasard qui intervient alors est celle que j’ai évoquée plus haut sous le nom de « contingence relativement à un système théorique ». Pour un généticien des populations, les effets physiologiques des interactions génétiques chez un organisme donné, et les valeurs sélectives des génotypes qui en résultent dans un milieu donné, sont des informations contingentes par rapport au système théorique assez idéalisé et simplificateur qui est le sien. En tant que théorie, la génétique des populations ne donne guère plus qu’une cinétique de la diffusion des gènes. Ceci ne signifie pas que l’interaction des gènes entre eux et avec le milieu externe soit inaccessible à l’investigation expérimentale. Mais ces phénomènes sont complexes, et hautement variables de cas à cas. Les informations que le biologiste rassemble sur eux ne s’intègrent guère dans une théorie globale qui permettrait de les déduire, et pas seulement de les constater.
4. Niveau des écosystèmes
À ce niveau, la situation épistémologique est semblable à celles des révolutions génétiques. La théorie évolutionniste ne s’occupe pas seulement de l’évolution interne de populations données, mais aussi des interactions entre populations appartenant à des espèces différentes (relations trophiques, compétition, parasitisme, coopération, etc.), et aussi des interactions entre ces ensembles et les paramètres du milieu physique (changements climatiques, modifications géographiques, etc.). À ce niveau aussi se produisent des effets fortuits, qui ont été souvent soulignés par les spécialistes en écologie. Maxime Lamotte a parlé d’« effet du fondateur de 3e ordre » pour les changements fortuits à l’échelle des biocoenoses et écosystèmes, la dérive génétique aléatoire étant un effet du fondateur de 1er ordre et la révolution génétique un « effet du fondateur de 2nd ordre [7] ». Les effets fortuits de 3e ordre se superposent évidemment aux effets fortuits de 1er et 2nd ordre. Mais ils ne s’y réduisent pas. Au niveau synécologique, la complexité des processus intervenant dans la modification de l’équilibre des faunes et des flores est en général au-delà du pouvoir de prédiction des modèles écologiques disponibles. On retrouve donc là une situation épistémologique similaire à celle des révolutions génétiques. Parler de hasard à ce niveau revient à dire que les modèles théoriques disponibles sont sous-déterminés relativement aux données expérimentales disponibles.
|
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 00:31 Mer 31 Mai 2017, 00:31 | |
| suite et fin - Citation :
5. Niveau macroévolutif (paléobiologie)
Stephen Jay Gould a mis l’accent sur la « contingence » de l’évolution à l’échelle des temps géologiques. L’immense succès de cette formule ne garantit pas pour autant sa rigueur. Je pense que les paléobiologistes et les évolutionnistes qui ont repris la thèse de la contingence de l’histoire de la vie à une grande échelle ont mélangé deux idées, qu’on peut dissocier à la lumière des concepts de hasard que j’ai mis en avant.
Lorsqu’ils parlent de la contingence de l’histoire de la vie, les paléobiologistes veulent d’abord dire que cette histoire, si elle était rejouée d’autres fois, aurait vraisemblablement un autre cours, et pourtant nous utiliserions les mêmes hypothèses explicatives générales, en particuliers des schèmes d’explication darwiniens, pour expliquer ces histoires différentes. Ceci tient à l’importance et à la complexité des conditions initiales qui interviennent dans les explications évolutionnistes. Si l’on apprécie cette situation épistémologique de manière optimiste, il est possible de dire, comme l’ont fait un certain nombre de philosophes de la biologie, à commencer par moi-même [8], que la biologie est fondamentalement une science historique, c’est-à-dire une science dans laquelle les schèmes explicatifs ultimes sont des schèmes de causalité historique plutôt que des schèmes nomologiques. Autrement dit, tout se résout en dernière analyse dans des chaînes d’événements irrémédiablement singulières. Mais on pourrait aussi dire que cette situation montre à quel point la documentation paléontologique est sous-déterminée par les théories explicatives disponibles, ce qui reviendrait à dire que les théories ne sont pas assez puissantes pour rendre compte des grandes classes de phénomènes auxquelles on a affaire. Ces phénomènes sont dès lors « contingents » par rapport aux théories dont on dispose. Ils sont comme ils sont. Nous retrouvons là la troisième notion de hasard plusieurs fois évoquée. Les faits débordent la capacité explicative des théories disponibles.
Toutefois, les paléobiologistes ont parfois à l’esprit une idée un peu différente lorsqu’ils parlent de contingence à l’échelle macroévolutive. L’un des arguments majeurs utilisé par les paléobiologistes qui ont contesté l’orthodoxie néo-darwinienne a été celui des extinctions de masse (Raup, Sepkoski, Jablonski). Dans les extinctions de masses, disent-ils, les espèces infortunées qui disparaissent ne le font pas parce qu’elles seraient moins performantes que leurs compétiteurs dans une course adaptative en réponse à des conditions écologiques données, comme le veut l’explication darwinienne standard des extinctions. Par exemple, si les diatomées ont survécu mieux que d’autres formes planctoniques lors des grandes extinctions du Crétacé, c’est parce qu’elles avaient la chance de posséder un trait favorable (la capacité de s’enkyster), qui avait évolué pour des raisons sans rapport avec les conditions physiques que celles qui ont engendré l’extinction de masse. Adaptées par des processus de dormance à l’hiver des régions polaires, dit-on, les diatomées se sont trouvées par chance avantagées lors d’un refroidissement brutal de la terre ; elles ne l’ont emporté qu’en raison de cette circonstance accidentelle, et non parce qu’elles auraient gagné la course à l’adaptation par sélection naturelle.
Le sens de la « contingence » invoquée ici n’est rien d’autre que le premier sens du hasard évoqué plus haut, à savoir la chance. Autrement dit, le concept de hasard qui fonctionne ici est rigoureusement le même qu’on invoque lorsqu’on dit, dans un contexte darwinien orthodoxe, que les mutations se produisent au hasard. Simplement l’échelle du phénomène est ici différente. Le mot « chance » apparaît d’ailleurs explicitement dans le titre même du livre de David Raup sur les extinctions : Extinction : Bad Genes or Bad Luck [9] ?
6. Autres cas
Nous n’avons considéré dans cet article que les phénomènes évolutifs fortuits solidement étayés dans la littérature évolutionniste moderne. Il convient de signaler par ailleurs deux domaines de recherche nouveaux qui prennent à l’heure actuelle une importance croissante, et qui portent tous deux sur des niveaux d’intégration relativement élevés des phénomènes évolutifs.
L’un concerne la dynamique de la diversification des espèces. Dans un livre récent, Stephen Hubbel a présenté un modèle stochastique de la genèse de la biodiversité. Selon ce modèle, caractérisé par l’auteur comme « hypothèse nulle », les probabilités d’apparition et d’extinction d’une espèce ont toutes chances d’être égales pour des espèces en compétition. L’avantage de ce modèle est de permettre une comparaison entre les degrés de biodiversité d’habitats différents. Cette approche de la genèse de la biodiversité est une alternative à l’approche fondée sur l’idée d’exclusion compétitive, classique en écologie théorique depuis Lotka, et reprise depuis par de nombreux auteurs. La notion de hasard qui intervient ici est la même que celle que nous avons vu fonctionner dans le cas de la dérive génétique aléatoire.
L’autre domaine de recherche que nous voudrions brièvement signaler est celui de l’évolution chaotique d’un certain nombre de systèmes biologiques. Dans de nombreux domaines, qui vont de la génétique théorique des populations et de l’écologie théorique à la modélisation des phénomènes paléobiologiques, on tend à faire une place significative aujourd’hui à des modèles non linéaires. De tels modèles conduisent à conférer un degré élevé d’imprévisibilité aux phénomènes, soit parce que leur modélisation met en oeuvre des équations dont les solutions divergent en fonction de modifications infimes dans les conditions initiales, soit parce qu’elles n’ont pas et ne peuvent pas avoir de solution (situation que les mathématiciens connaissent bien depuis les travaux de Poincaré). S’il s’avérait que de tels modèles fussent justifiés dans de nombreuses situations en évolution, il y aurait lieu de souligner là une notion de hasard différente de celles que nous avons examinées.
Conclusion
En conclusion, il est légitime de soulever deux questions. D’une part les diverses modalités du hasard que nous avons identifiées dans le discours évolutionniste sont-elles vraiment distinctes, ou peuvent-elles se ramener à l’unité ? D’autre part, s’agit-il d’un hasard subjectif, c’est-à-dire d’un hasard dû aux limites de notre pouvoir de connaissance, ou d’un hasard objectif ? Les deux questions sont liées. À première vue, toutes les formes de hasard que nous avons évoquées semblent relever d’un hasard subjectif : la chance du jardinier ou du mutant avantagé n’est du hasard qu’au regard de notre connaissance limitée de l’ensemble des séries de causes et d’effets. De même, le hasard stochastique de la dérive aléatoire n’est un hasard que parce que nous n’avons qu’une vision massale et statistique de ce phénomène. La dérive aléatoire des généticiens n’est pas un hasard radical comme celui de la mécanique quantique, c’est un hasard qui résulte de notre incapacité à suivre dans le détail toute la série des événements physiquement déterministes qui interviennent dans la production des gamètes. Enfin la notion de contingence relativement à un système théorique est de manière explicite une reconnaissance de la capacité limitée des modèles théoriques disponibles.
Si tous ces hasards sont subjectifs, il est donc tentant de dire qu’ils renvoient en définitive à diverses situations d’imprévisibilité dont chacune illustre la limitation de notre connaissance.
Il est cependant possible de voir les choses dans une autre perspective philosophique. Nous voudrions rappeler ici la conception du hasard dont Antoine Augustin Cournot s’est fait l’avocat au siècle dernier. Pour Cournot, le hasard devait être interprété comme une notion objective, disant quelque chose du Monde et pas seulement de notre pouvoir de connaissance. C’est en effet ainsi qu’il faut comprendre la célèbre formule définissant le hasard comme combinaison de séries causales indépendantes. Cette définition était liée chez Cournot à une forte réticence à l’endroit du déterminisme universel laplacien. Cournot récusait l’idée d’un ordre du monde donné une fois pour toutes de manière synoptique au prix de la fiction d’un calculateur parfaitement informé. Il lui préférait l’idée qu’il existe objectivement des ordres du monde partiellement distincts, que la causalité doit être pensée en référence à ces mondes partiellement isolés et partiellement connectés, et que c’est cela qui nous permet (selon la belle formule de Bertrand Saint-Sernin commentant Cournot), de comprendre que « l’univers a une histoire réelle, [et qu’]il s’est fait par une suite d’événements dont aucun n’était la conséquence nécessaire des événements qui l’avaient précédé et dont aucun n’est porteur d’une série de conséquences nécessaires [10] ».
On nous pardonnera j’espère ce retournement dialectique. Il arrive toujours un moment où, en science comme en philosophie, l’argumentation doit céder le pas à la décision. L’importance extrême que prend la notion du hasard en évolution, avec ses variétés subtiles, témoigne abondamment du caractère historique de l’évolution et fournit une des plus belles illustrations de la vision cournotienne du monde comme constitué de systèmes partiellement isolés et partiellement connectés à toutes les échelles de description.
|
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 01:26 Mer 31 Mai 2017, 01:26 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- 11.04.2017
Bonjour,
Je vous propose de réfléchir à notre rapport au hasard.
Je souhaite montrer que nous ne sommes pas objectifs dans notre rapport au hasard.
En effet, notre intellect nous conduit à rechercher un sens, des solutions à tout. Les faits sont pour nous des données que nous analysons pour leur chercher un sens. Il se trouve que nous sommes également dépassés par ce schéma intellectuel... car nous cherchons un sens à ce qui n'en a pas nécessairement.
Attention il est interdit en Islam d'avoir des rapports au hasard. On ne peut avoir de rapport qu'avec nos épouse.  |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 01:36 Mer 31 Mai 2017, 01:36 | |
| - salamsam a écrit:
- emmanuelle78 a écrit:
- 11.04.2017
Bonjour,
Je vous propose de réfléchir à notre rapport au hasard.
Je souhaite montrer que nous ne sommes pas objectifs dans notre rapport au hasard.
En effet, notre intellect nous conduit à rechercher un sens, des solutions à tout. Les faits sont pour nous des données que nous analysons pour leur chercher un sens. Il se trouve que nous sommes également dépassés par ce schéma intellectuel... car nous cherchons un sens à ce qui n'en a pas nécessairement.
Attention il est interdit en Islam d'avoir des rapports au hasard. On ne peut avoir de rapport qu'avec nos épouse.
 arrête après on va te rappeler à quel point tu ne penses qu'à ca............ |
|   | | Invité
Invité
 | |   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mer 31 Mai 2017, 01:50 Mer 31 Mai 2017, 01:50 | |
| - Cyril 84 a écrit:
- emmanuelle78 a écrit:
- Bonjour,
Je vous propose de réfléchir à notre rapport au hasard.
Je souhaite montrer que nous ne sommes pas objectifs dans notre rapport au hasard.
En effet, notre intellect nous conduit à rechercher un sens, des solutions à tout. Les faits sont pour nous des données que nous analysons pour leur chercher un sens. Il se trouve que nous sommes également dépassés par ce schéma intellectuel... car nous cherchons un sens à ce qui n'en a pas nécessairement.
Aujourd'hui lorsque je marchais 2 invités se sont posés sur mon doigt sans que je ne m'en aperçoive :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quelle probabilité y-avait-il que cela se produise ?
Cela ne m'est jamais arrivé.
Ils ont quand même choisi mon doigt comme "alcôve" pour se reproduire !
Et comble de la coïncidence, cela se passe le lendemain de l'ouverture de ce sujet... Enorme Cyril.  Vraiment des sans gènes ces coccinelles.  |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Jeu 08 Juin 2017, 23:33 Jeu 08 Juin 2017, 23:33 | |
| NOTRE PERCEPTION DU HASARD Peut-on se fier à notre intuition pour prendre une décision ? par Nicolas Gauvrit. Présentation Michel Faup, synthèse Laurence Honnorat. Cnes, Matinales de idées (qui est Nicolas Gaucrit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je ferais un résumé si j'ai le temps plus tard! sinon: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Ven 04 Aoû 2017, 23:05 Ven 04 Aoû 2017, 23:05 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]une emission de radio de france culture:( 1h) Pourquoi le hasard n'existe pas discussion entre des biologistes, des physiciens, des mathématiques. Klein, Ameisen.. |
|   | | Raphaël#

 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Sam 05 Aoû 2017, 23:57 Sam 05 Aoû 2017, 23:57 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
une emission de radio de france culture:( 1h)
Pourquoi le hasard n'existe pas
discussion entre des biologistes, des physiciens, des mathématiques.
Klein, Ameisen.. Merci pour le partage ! Vive le hasard ! Je retiens la belle citation de David Gross : "La science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance de demain !" |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Dim 06 Aoû 2017, 00:21 Dim 06 Aoû 2017, 00:21 | |
| J'ai bien aimé une explication de 'je ne sais plus quel intervenant'.
Le hasard pur... on sait le reconnaitre.
Si on lance un dé, on sait calculer la probabilité d'apparition de telle ou telle face, et ca marche ca se vérifie, on maitrise, on peut prévoir.
Par contre, si on lance un dé qu'on sait pipé et rien de plus... on ne peut plus rien calculer, on ne peut plus rien prévoir.
(d'ailleurs en biologie on repère les mutations sélectionnées quand justement elles ne répondent plus aux règles de la probabilité de variabilité... les mutations aléatoires et non sélectionnées, on sait très bien calculer leur diffusion dans une population... mais les mutations sélectionnées elles sont non prévisibles... car l'apparition d'un avantage est contingent et non du hasard pur. Le hasard pur ne dépend d'aucune contingence, quand la contingence, elle induit une quantité de facteurs empechant une prévisibilité car trop complexe.) |
|   | | Raphaël#

 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Dim 06 Aoû 2017, 02:44 Dim 06 Aoû 2017, 02:44 | |
| - emmanuelle78 a écrit:
- J'ai bien aimé une explication de 'je ne sais plus quel intervenant'.
Le hasard pur... on sait le reconnaitre.
Si on lance un dé, on sait calculer la probabilité d'apparition de telle ou telle face, et ca marche ca se vérifie, on maitrise, on peut prévoir.
Par contre, si on lance un dé qu'on sait pipé et rien de plus... on ne peut plus rien calculer, on ne peut plus rien prévoir.
(d'ailleurs en biologie on repère les mutations sélectionnées quand justement elles ne répondent plus aux règles de la probabilité de variabilité... les mutations aléatoires et non sélectionnées, on sait très bien calculer leur diffusion dans une population... mais les mutations sélectionnées elles sont non prévisibles... car l'apparition d'un avantage est contingent et non du hasard pur. Le hasard pur ne dépend d'aucune contingence, quand la contingence, elle induit une quantité de facteurs empechant une prévisibilité car trop complexe.) Oui c'était un bel exemple de Pierre-Henri Gouyon. Ah ben si la contingence était prévisible, ce ne serait que du hasard !  Et si causalité, plus de hasard ni de contingence. En tous cas, essayer d'appréhender la complexité de l'évolution, le hasard/contingence à l'oeuvre, est pour moi, tout aussi vertigineux et merveilleux que de contempler les étoiles et d'essayer d'appréhender l'univers. ! Forcément me diras-tu !  Il termine par un fait que j'ai pu maintes fois constater " ...l'apparition de l'homme n'était pas inéluctable sur terre et ça certaines personnes ne peuvent pas le supporter." Par contre j'avais déjà entendu les passages d'Etienne Klein, je me demande si ce n'était pas sur ce forum, très certainement dans un autre de tes posts, je chercherai. |
|   | | mario-franc_lazur
Administrateur - Fondateur


 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  Mar 04 Aoû 2020, 18:23 Mar 04 Aoû 2020, 18:23 | |
| - Raphaël# a écrit:
- emmanuelle78 a écrit:
- J'ai bien aimé une explication de 'je ne sais plus quel intervenant'.
Le hasard pur... on sait le reconnaitre.
Si on lance un dé, on sait calculer la probabilité d'apparition de telle ou telle face, et ca marche ca se vérifie, on maitrise, on peut prévoir.
Par contre, si on lance un dé qu'on sait pipé et rien de plus... on ne peut plus rien calculer, on ne peut plus rien prévoir.
(d'ailleurs en biologie on repère les mutations sélectionnées quand justement elles ne répondent plus aux règles de la probabilité de variabilité... les mutations aléatoires et non sélectionnées, on sait très bien calculer leur diffusion dans une population... mais les mutations sélectionnées elles sont non prévisibles... car l'apparition d'un avantage est contingent et non du hasard pur. Le hasard pur ne dépend d'aucune contingence, quand la contingence, elle induit une quantité de facteurs empechant une prévisibilité car trop complexe.)
Oui c'était un bel exemple de Pierre-Henri Gouyon.
Ah ben si la contingence était prévisible, ce ne serait que du hasard !  Et si causalité, plus de hasard ni de contingence. Et si causalité, plus de hasard ni de contingence.
En tous cas, essayer d'appréhender la complexité de l'évolution, le hasard/contingence à l'oeuvre, est pour moi, tout aussi vertigineux et merveilleux que de contempler les étoiles et d'essayer d'appréhender l'univers. ! Forcément me diras-tu ! 
Il termine par un fait que j'ai pu maintes fois constater " ...l'apparition de l'homme n'était pas inéluctable sur terre et ça certaines personnes ne peuvent pas le supporter."
Et de même d'ailleurs l'apparition de la vie. |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Notre rapport au hasard Sujet: Re: Notre rapport au hasard  | |
| |
|   | | | | Notre rapport au hasard |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
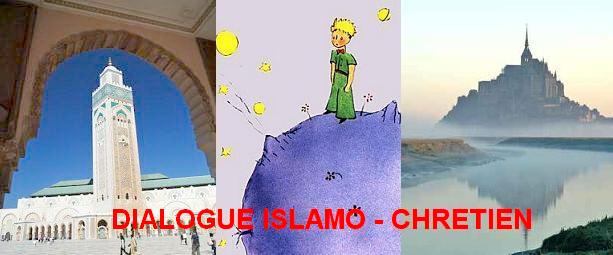



 Mar 11 Avr 2017, 00:42
Mar 11 Avr 2017, 00:42
 excellent cette petite démonstration!!!
excellent cette petite démonstration!!!

 c'est très intéressant
c'est très intéressant


